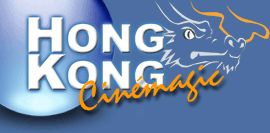|
Master With Cracked Fingers (1974) |
 |
 |

 Jackie, un serveur, part venger la mort de son père. Pour ce faire, il doit subir un dur entraînement auprès d’un vieil ermite excentrique. Jackie, un serveur, part venger la mort de son père. Pour ce faire, il doit subir un dur entraînement auprès d’un vieil ermite excentrique.
 Être une star, ça ne s’improvise pas. Mais est-on réellement une étoile, ou le devient-on ? Une question qui mérite d’être posée, tant le chemin jusqu’à la gloire peut être facile pour les uns, et semé d’embûches pour les autres. Si des acteurs comme Bruce Lee ou James Dean n’ont eu qu’à tourner une poignée de films pour rentrer dans la légende, d’autres ont dû faire preuve d’une détermination farouche pour prétendre à un tel statut. C’est le cas de Jackie Chan, qui semblait condamné à n’être qu’un de ces artistes martiaux improvisés acteurs sans aucun charisme, comme il y en avait des dizaines à l’époque. La genèse de Master With Cracked Fingers est assez surprenante. Tourné en 1971 sous le titre Little Tiger From Canton, le montage original n’était ni assez long si assez spectaculaire pour rester dans les annales. Chan avait déjà tourné quelques petits rôles, mais il s’agissait de son premier rôle principal. Malheureusement, n’ayant pas encore atteint la gloire, son aura n’était pas suffisante pour obtenir le succès, et Master With Cracked Fingers est tombé dans l’oubli pendant des années. Puis Ng See Yuen et Yuen Woo Ping unirent leurs forces pour exploiter le talent de Jackie, avec les résultats que l’on connaît. Le public, qui jusque-là avait boudé les salles, voit en Chan sa nouvelle idole, et ne peut se contenter du peu de films dans lesquels il a joué. On connaissait la Brucexploitation, et bien avec Master With Cracked Fingers, c’était un peu le début de la Jackiexploitation, genre à part entière, moins célèbre et usé que l’emploi de clones de Bruce Lee, mais tout aussi surprenante. Faistan Film Co. décide en effet qu’il n’y a pas de raison de ne pas profiter du gâteau, et ressort son vieux film des cartons. Seulement voilà, pour justifier une sortie, il faut une durée minimale, et le montage ne dépasse pas les trois quarts d’heure. Mais un tel obstacle n’a jamais arrêté les réalisateurs hongkongais, comme Godfrey Ho l’a prouvé ardemment tout au long de sa carrière. C’était qui déjà ce vieux qui balbutiait des phrases kung fu ? Simon Yuen ? Amenez-le sur le plateau. Maintenant on passe un casting vite fait : « cherche artiste martial avec un nez fort des cheveux longs, environ 1m73. Ben voilà, on l’a notre Jackie ! Comment ça il ne ressemble pas au vrai, même de dos ? Ben c’est simple : on le filme de dos, mais on ne montre que son épaule. Et quand on doit le montrer de face, il porte un bandeau, après tout c’est cool de se battre les yeux bandés ! Et si on est obligé de le montrer de face, il faut que ce soit dans l’ombre ! Après tout c’est logique que le visage de Simon Yuen soit visible et celui du faux Jackie obscurci par l’ombre ! Et puis on peut aussi lui demander de mettre son bras devant sa tête, après tout, tout le monde fait ça pour taper la discussion ! ça va être un film du tonnerre ! ». Et voilà comment ce petit produit sans ambition a pu devenir…. Une escroquerie sans ambition. Être une star, ça ne s’improvise pas. Mais est-on réellement une étoile, ou le devient-on ? Une question qui mérite d’être posée, tant le chemin jusqu’à la gloire peut être facile pour les uns, et semé d’embûches pour les autres. Si des acteurs comme Bruce Lee ou James Dean n’ont eu qu’à tourner une poignée de films pour rentrer dans la légende, d’autres ont dû faire preuve d’une détermination farouche pour prétendre à un tel statut. C’est le cas de Jackie Chan, qui semblait condamné à n’être qu’un de ces artistes martiaux improvisés acteurs sans aucun charisme, comme il y en avait des dizaines à l’époque. La genèse de Master With Cracked Fingers est assez surprenante. Tourné en 1971 sous le titre Little Tiger From Canton, le montage original n’était ni assez long si assez spectaculaire pour rester dans les annales. Chan avait déjà tourné quelques petits rôles, mais il s’agissait de son premier rôle principal. Malheureusement, n’ayant pas encore atteint la gloire, son aura n’était pas suffisante pour obtenir le succès, et Master With Cracked Fingers est tombé dans l’oubli pendant des années. Puis Ng See Yuen et Yuen Woo Ping unirent leurs forces pour exploiter le talent de Jackie, avec les résultats que l’on connaît. Le public, qui jusque-là avait boudé les salles, voit en Chan sa nouvelle idole, et ne peut se contenter du peu de films dans lesquels il a joué. On connaissait la Brucexploitation, et bien avec Master With Cracked Fingers, c’était un peu le début de la Jackiexploitation, genre à part entière, moins célèbre et usé que l’emploi de clones de Bruce Lee, mais tout aussi surprenante. Faistan Film Co. décide en effet qu’il n’y a pas de raison de ne pas profiter du gâteau, et ressort son vieux film des cartons. Seulement voilà, pour justifier une sortie, il faut une durée minimale, et le montage ne dépasse pas les trois quarts d’heure. Mais un tel obstacle n’a jamais arrêté les réalisateurs hongkongais, comme Godfrey Ho l’a prouvé ardemment tout au long de sa carrière. C’était qui déjà ce vieux qui balbutiait des phrases kung fu ? Simon Yuen ? Amenez-le sur le plateau. Maintenant on passe un casting vite fait : « cherche artiste martial avec un nez fort des cheveux longs, environ 1m73. Ben voilà, on l’a notre Jackie ! Comment ça il ne ressemble pas au vrai, même de dos ? Ben c’est simple : on le filme de dos, mais on ne montre que son épaule. Et quand on doit le montrer de face, il porte un bandeau, après tout c’est cool de se battre les yeux bandés ! Et si on est obligé de le montrer de face, il faut que ce soit dans l’ombre ! Après tout c’est logique que le visage de Simon Yuen soit visible et celui du faux Jackie obscurci par l’ombre ! Et puis on peut aussi lui demander de mettre son bras devant sa tête, après tout, tout le monde fait ça pour taper la discussion ! ça va être un film du tonnerre ! ». Et voilà comment ce petit produit sans ambition a pu devenir…. Une escroquerie sans ambition.
Et pour s’assurer que le public soit complice, c’est la nouvelle intrigue qui ouvre le bal, avec une scène d’entraînement insipide. A noter qu’il semble difficile de trouver le film dans sa version originale. La VHS anglaise ajoute un charme certain à cette pantalonnade, grâce à des comédiens de doublage tous enrhumés et des dialogues qui tentent vainement de lier deux intrigues tellement différentes qu’on a continuellement la sensation de regarder deux films différents. Les scènes ajoutées, plus modernes, sont aussi les plus mauvaises. L’histoire y est identique à tous les kung fu de l’époque : rivalités, quête de vengeance, le fils qui doit laver le nom de sa famille, et les inévitables entraînements. Le ton se veut comique, Dean Shek faisant caution en la matière, et Simon Yuen s’évertuant à grimacer, tout en étant de moins en moins capable de bouger de façon convaincante. Le voir s’évertuer à rouler par terre est réellement pathétique, mais pas autant que l’affreuse perruque brune dont il est affublé. On aurait pu penser que les producteurs tenteraient d’insuffler une cohérence d’ensemble, mais rien ne va dans ce sens. Toutefois, il faut reconnaître une certaine inventivité : afin de limiter le temps de présence de la doublure, le premier quart d’heure est occupé par le personnage enfant, apprenant aux côtés de Simon Yuen. Alors que dans l’intrigue originale, il n’est jamais question de l’enfance du héros, ni de l’origine de ses dons pour les arts martiaux, ici cet apprentissage est interminable, et présente son lot de scènes risibles ou inquiétantes. On s’étonnera par exemple de voir le père Yuen commandé à l’enfant de se déshabiller intégralement la nuit dans la forêt, avant de l’enfermer dans un sac avec des serpents. Si le ton est à la rigolade, ce passage est discutable non seulement en termes d’intérêt, mais aussi pour ses connotations évidentes. Mais le plus ahurissant reste que les nouvelles scènes sont tout aussi mal mises en scène que les anciennes, comme l’illustrent les innombrables hors champs qui cachent l’action. C’est parfois volontaire, mais c’est souvent la marque d’un manque de savoir-faire. On a de toutes manières bien du mal à imaginer un metteur en scène talentueux s’aventurer dans une telle entreprise. Finalement, au bout de quinze minutes, la véritable histoire débute, avec une démonstration d’acrobaties d’un tout jeune Jackie Chan. Mais qu’on se rassure, afin de ne pas oublier les nouvelles scènes, de réguliers inserts de Simon Yuen viennent faire le lien entre les deux récits, à la manière de Rudy Ray Moore dans Shaolin Dolemite. Quand enfin on peut contempler l’œuvre originale, on constate que n’étant pas encore passé par la case chirurgie, Chan possède un physique très marqué, qui lui donne un côté sauvage et une véritable présence. Le ton se fait immédiatement plus sérieux, même si l’acteur a déjà tendance à grimacer dans les scènes avec sa sœur. L’histoire est bien loin des apprentissages et des rivalités entre maîtres. Il est question de petits voyous qui terrorisent un village, et Jackie, simple serveur, va intervenir totalement par hasard.
Et c’est bien l’intérêt du récit : les confrontations vont s’enchaîner (on a d’ailleurs l’impression qu’il n’y a que des combats dans cette partie) et la tension va monter crescendo. Ce qui débute comme une action héroïque va devenir un lutte à mort, les gangsters ne cessant de harceler le héros et sa famille, allant même jusqu’à brûler le domicile familial. Les combats, chorégraphiés par Chan, sont surprenants. Ils sont brutaux et violents, dans un style qui se veut plus proche du combat de rue que du kung fu technique. L’acteur y est tout de même bondissant, et enchaîne les coups de pied avec une régularité peu commune chez lui. Mais c’est surtout la montée en violence des affrontements, de plus en plus brutaux, qui impressionne. Chan est très crédible, non seulement physiquement, mais aussi dans sa façon d’exprimer la rage d’un honnête jeune homme accablé pour avoir voulu bien faire. La relation avec le père, incarné par Tien Feng, est d’ailleurs intéressante, puisque ce dernier lui interdit de se battre en toutes circonstances. Les relations familiales semblaient prometteuses, notamment avec l’intervention de la sœur, mais elles restent trop en retrait. Elles donnent tout de même lieu à quelques scènes importantes, comme les punitions sadiques du père, qui va jusqu’à obliger son fils à plonger sa main dans du verre pilé. Le nouveau montage impose Simon Yuen comme une sorte de seconde figure paternelle, qui pousse au contraire le héros à se battre et le punit lorsqu’il s’y refuse. Ce parti-pris renforce largement les incohérences et contradictions entre les différentes scènes, ce dont Master With Cracked Fingers n’avait vraiment pas besoin. En effet, même sans le nouveau montage, l’intrigue devient rapidement totalement incompréhensible. Certaines scènes sont coupées en plein milieu, des combats cessent pour se transformer en dialogues, à l’inverse, certains affrontements débutent sans qu’on sache pourquoi, et dans une même scène, les acteurs changent de vêtements sans raison. On a presque l’impression de regarder Kung Pow ! Mais ce délire narratif reste plus ou moins efficace grâce à la sauvagerie de plus en plus évidente des combats, qui atteint des sommets dans le vrai final sur les docks. Il y a même une véritable intensité émotionnelle, qui renforce de façon évidente l’impact d’une chorégraphie pas inoubliable mais percutante et fraiche. Concrètement, Master With Cracked Fingers n’avait rien pour être un grand film, mais méritait que les fans de l’acteur le regardent pour ses combats violents et son jusqu’au boutisme.
Mais l’ajout des nouvelles scènes, et donc d’un nouveau final donne un côté bis intéressant à défaut d’être divertissant. Il faut dire qu’après le spectacle auquel on vient d’assister, il est difficile de prendre au sérieux le duel yeux bandés qui suit. La chorégraphie est plus technique, mais aussi et surtout plus molle, et l’équipe ne parvient jamais à nous faire croire qu’il s’agit du même film. Dans certains inserts, les acteurs sont censés être au même endroit alors qu’il est évident que le décor derrière eux n’est pas le même. Applaudissons toutefois l’audace des inserts de Drunken Master, alors que la technique employée par la doublure n’a rien à voir. Le yes-man en question parvient par contre assez bien à imité la gestuelle de Jackie, mais les mouvements sont tellement répétitifs qu’on ne se prend jamais au jeu. Par chance, le mot fin apparaît assez tôt. Assez court, Master With Cracked Fingers ne mérite d’être vu que par les fans absolus de la star, en ayant conscience qu’il est recommandé de faire avance rapide pour les nouvelles scènes.
|
 |
 |
Léonard Aigoin 2/24/2011 - haut |
 |
 |
Kung Fu Hustle (2004) |
 |
 |

 Dans le Canton des années 40, un jeune voyou essaye de rejoindre le gang des Haches en défiant des maitres en Kung Fu se faisant passer pour des propriétaires d'immeubles populaires où reigne une faune particuliérement dejantée ! Dans le Canton des années 40, un jeune voyou essaye de rejoindre le gang des Haches en défiant des maitres en Kung Fu se faisant passer pour des propriétaires d'immeubles populaires où reigne une faune particuliérement dejantée !
 Si le cinéma est un art, on peut estimer que le mo lei tau en est un autre. Wong Jing expliquait dans une interview donnée sur le site, qu’il s’agissait d’un juron qu’employaient les Hongkongais lorsqu’ils ne comprenaient pas l’humour des films qu’il tournait avec Stephen Chow (notamment à cause de références nombreuses aux mangas). En somme, on pourrait définir ce style d’humour comme une succession de non-sens, dont le déroulement se fait bien souvent en dépit des règles de narration. L’humour absurde primant alors sur le développement des personnages ou de l’intrigue. Et si l'Angleterre a eu les Monthy Python pour vendre ce genre particulier, à Hong Kong, c’est Stephen Chow qui en reste le représentant le plus spectaculaire. Si ses débuts aux côtés de Danny Lee ou Jet Li et une tripotée de films sans genre particulier ne laissaient pas supposer qu’il deviendrait le roi de l’humour cantonais, sa rencontre avec le metteur en scène Jeff Lau allait changer la donne. L’acteur avait déjà eu l’occasion de s’illustrer dans des comédies, mais c’est la fausse suite de God Of Gamblers, All For The Winner, qui va lui permettre de créer son personnage. Qu’il soit naïf, roublard, débonnaire ou escroc, le héros Chowien est avant tout un loser, qui va devoir traverser des épreuves plutôt folkloriques afin de retrouver, voire de trouver sa dignité. Cette recette restera inchangée tout au long de sa carrière, néanmoins à partir de la fin des années 90, la star s’engage dans une voie plus complexe. La violence est plus présente, le ton plus pessimiste, et la narration plus rigoureuse. A ce titre, King Of Comedy est un peu l’œuvre de la transition, et l’acteur, qui enchaînait les tournages jusque-là, va se faire de moins en moins présent sur les écrans. Il faudra attendre 2 ans pour que son ambitieux projet, Shaolin Soccer, voit le jour. Plus accessible que ses comédies précédentes, il sera exporté en occident, notamment en France, où il aura droit à une sortie dans les salles obscures. Si Jackie Chan et Jet Li ont l’argument évident de leurs prouesses physiques pour se vendre à l’étranger, Stephen Chow est davantage connu pour sa diction fluide et frénétique que ses talents de combattant. Pourtant dans Shaolin Soccer, il démontre des aptitudes qu’on avait déjà aperçues, ce qui a certainement facilité cette ouverture. Le succès aidant, une succursale asiatique de Columbia Pictures fit office de producteur pour le nouveau projet de la star, Kung Fu Hustle. Stephen Chow a toujours revendiqué son amour des arts martiaux, et notamment de celui qu’il considère comme le maître, Bruce Lee. Au début du tournage, il s’est donc lancé à la recherche d’authentiques artistes martiaux, afin de présenter des affrontements spectaculaires et crédibles. Et les photos de production, présentant des centaines de figurants armés de haches, suffisaient largement à faire revivre les sensations provoquées par les combats des films de Chang Cheh. Si le cinéma est un art, on peut estimer que le mo lei tau en est un autre. Wong Jing expliquait dans une interview donnée sur le site, qu’il s’agissait d’un juron qu’employaient les Hongkongais lorsqu’ils ne comprenaient pas l’humour des films qu’il tournait avec Stephen Chow (notamment à cause de références nombreuses aux mangas). En somme, on pourrait définir ce style d’humour comme une succession de non-sens, dont le déroulement se fait bien souvent en dépit des règles de narration. L’humour absurde primant alors sur le développement des personnages ou de l’intrigue. Et si l'Angleterre a eu les Monthy Python pour vendre ce genre particulier, à Hong Kong, c’est Stephen Chow qui en reste le représentant le plus spectaculaire. Si ses débuts aux côtés de Danny Lee ou Jet Li et une tripotée de films sans genre particulier ne laissaient pas supposer qu’il deviendrait le roi de l’humour cantonais, sa rencontre avec le metteur en scène Jeff Lau allait changer la donne. L’acteur avait déjà eu l’occasion de s’illustrer dans des comédies, mais c’est la fausse suite de God Of Gamblers, All For The Winner, qui va lui permettre de créer son personnage. Qu’il soit naïf, roublard, débonnaire ou escroc, le héros Chowien est avant tout un loser, qui va devoir traverser des épreuves plutôt folkloriques afin de retrouver, voire de trouver sa dignité. Cette recette restera inchangée tout au long de sa carrière, néanmoins à partir de la fin des années 90, la star s’engage dans une voie plus complexe. La violence est plus présente, le ton plus pessimiste, et la narration plus rigoureuse. A ce titre, King Of Comedy est un peu l’œuvre de la transition, et l’acteur, qui enchaînait les tournages jusque-là, va se faire de moins en moins présent sur les écrans. Il faudra attendre 2 ans pour que son ambitieux projet, Shaolin Soccer, voit le jour. Plus accessible que ses comédies précédentes, il sera exporté en occident, notamment en France, où il aura droit à une sortie dans les salles obscures. Si Jackie Chan et Jet Li ont l’argument évident de leurs prouesses physiques pour se vendre à l’étranger, Stephen Chow est davantage connu pour sa diction fluide et frénétique que ses talents de combattant. Pourtant dans Shaolin Soccer, il démontre des aptitudes qu’on avait déjà aperçues, ce qui a certainement facilité cette ouverture. Le succès aidant, une succursale asiatique de Columbia Pictures fit office de producteur pour le nouveau projet de la star, Kung Fu Hustle. Stephen Chow a toujours revendiqué son amour des arts martiaux, et notamment de celui qu’il considère comme le maître, Bruce Lee. Au début du tournage, il s’est donc lancé à la recherche d’authentiques artistes martiaux, afin de présenter des affrontements spectaculaires et crédibles. Et les photos de production, présentant des centaines de figurants armés de haches, suffisaient largement à faire revivre les sensations provoquées par les combats des films de Chang Cheh.
Mais les influences de Chow sont multiples, et son ambition est grande. Le budget alloué, plutôt conséquent, est largement mis à profit pour donner vie au Shanghai des années 40, comme en témoignent les magnifiques décors et les spectaculaires néons des boutiques, brillant comme autant de témoins d’une époque révolue. On pense d’ailleurs par moment au Miracles de Jackie Chan, mais l’ambiance est finalement très différente. Il faut dire que la star s’est davantage investie en tant que réalisateur, insufflant un véritable style à sa mise en scène, que ni ses précédents essais, ni son CJ7 ne laissent imaginer. La première scène est particulièrement efficace, et représente parfaitement l’esprit du film. Son mélange habile de violence fulgurante, de visuels flamboyants, et d’humour décalé annonce immédiatement la couleur. Cette introduction, aux mouvements de caméras amples et élégants, restera longtemps dans les annales, non seulement pour sa brutalité surprenante, mais aussi pour sa fameuse danse ses haches, véritable moment d’anthologie, rappelant les déhanchements de Tony Leung Ka Fai dans Jiang Hu : The Triad Zone. Bien vite, on ne sait plus à quoi s’attendre. Ce gang sans foi ni loi, dont la première apparition rappelle les gangsters se déplaçant par centaine dans le Boxer From Shantung de Chang Cheh, ne serait donc qu’une vaste blague ? Chow ne facilite pas la tâche à son public, en choisissant par exemple de n’apparaître à l’écran que sporadiquement, même s’il devient une figure plus centrale dans la deuxième partie de l’intrigue. Il n’y a d’ailleurs pas de héros à proprement parler, qu’on suivrait du début à la fin. A la manière du Shogun And Little Kitchen de Ronny Yu, c’est bien la résidence du porc, véritable village, qui reste LE personnage. Cet aspect vie quotidienne simple et sincère est touchant, et rappelle un peu le House Of 72 Tenants que Chu Yuan avait réalisé pour la Shaw Brothers. Les scènes de comédie, très vaudeville, contribuent largement à nous immerger dans cette vie d’un autre temps, illustrée par une bande originale qui se fait plus traditionnelle. Les musiques sont d’ailleurs toujours en accord avec l’action, swingantes quand le gang des haches se fait menaçant, dans un vrai style film noir, et traditionnelle et enthousiasmante comme dans un Heroes Of The East lorsque les poings dansent. Le contraste musical souligne la différence de ton entre la grande ville flamboyante et la petite résidence crasseuse.
On imagine largement où Chow a puisé son inspiration, comme dans cette scène où assis au milieu de sans abri, il crie son ambition dévorante et sa rage de s’échapper d’une destinée morose mais qui semble toute tracée. S’il renoue avec un jeu plus outré que dans Shaolin Soccer, l’acteur nous rappelle que ses capacités dramatiques sont évidentes, et on peut supposer qu’il puise l’inspiration dans son propre vécu. Son personnage reste dans la tradition de sa filmographie, un paumé, qui tente de creuser son trou, et va devoir se battre pour retrouver sa dignité. L’utilisation du flashback est classique, mais elle illustre efficacement le désenchantement de ce personnage, et le côté universel de la confrontation à la réalité est réellement touchant. La galerie de personnages est de toutes manières très attachante, grâce à des acteurs investis, mais aussi à des scènes iconiques. L’adieu des 3 maîtres, en plus d’être l’un des affrontements les plus techniques, est réalisé avec classe, et rappelle les confrontations pleines de respect des films de kung fu d’antan. Car même si l’humour est présent, Kung Fu Hustle reste un film d’action, et les quatre gros combats représentent une part non négligeable de la pellicule. A l’origine, c’est Sammo Hung qui devait faire office de chorégraphe, mais une maladie et quelques désaccords l’ont poussé à quitter le tournage. Les notes de production informent de la suppression de son travail, mais on peut se demander si certains duels, comme celui opposant les vétérans Fung Hak On et Chu Chi Ling ne sont pas son travail. Les échanges au corps à corps sont en effet plus complexes et plus impressionnants que les combats à grande échelle. On a bien sûr toujours plaisir à voir un héros lutter seul contre cent adversaires, ou 3 héros contre cent gangsters, mais comme souvent, les figurants attaquent un par un. En particulier dans le final, qui voit Chow singer le Bruce Lee de Fist Of Fury, allant jusqu’à reproduire ses moindres mouvements. Mais on peut y voir une volonté dans ce cas précis. Le premier duel de masse est plus réussi de ce point de vue, car les cascadeurs fondent littéralement sur les héros (même s’ils ne les attaquent pas avec trop de violence). Le mélange effets spéciaux numériques, câbles, et prouesses physiques réelles fonctionne plutôt bien, mais la chorégraphie privilégie les acrobaties spectaculaires et les chutes qui font mal aux échanges longs et complexes. Il y a bien quelques parades intéressantes, en particulier quand les trois maîtres font quelques passes, ou dans le duel susmentionné, mais il ne faut pas s’attendre à une véritable bible des arts martiaux. Reste que le plaisir est là, on retrouve cette ambiance si particulière des films de kung fu traditionnels, et un véritable amour pour le genre. Cet enthousiasme est communicatif, grâce à un montage habile. La présence de vétérans comme Bruce Leung ou Yuen Wah n’est pas non plus étrangère à cette allégresse, d’autant qu’ils sont employés comme de véritables acteurs, et se montrent convaincant, y compris dans les scènes dramatiques ou comiques.
Car le tragique n’est jamais loin du burlesque, et même si les innombrables références sont plus accessibles que d’habitude au public occidental, le mélange des genres typiquement cantonais reste un élément important. On retrouve d’ailleurs le comique à répétition cher à la star, rappelant par exemple le gag récurrent du feu dans A Chinese Odyssey : Pandora's Box, qui sera d’ailleurs plus ou moins cité. Les inspirations sont éclectiques, allant de Tex Avery à Matrix, en passant par Nikki Larson et The Shining et s’inscrivent dans la logique du film. On s’étonnera davantage de la fameuse réplique de Spiderman sur le pouvoir et les responsabilités, plus ou moins utilisés à contresens ici. En effet, c’est la mort d’un être cher qui a poussé le jeune Peter Parker à utiliser ses pouvoirs pour faire le bien. Au contraire, c’est le décès de leur fils qui pousse le couple Yuen Wah/Yuen Qiu à vivre dans l’ombre, rappelant les difficultés à mener une vie quand on est un maître, comme évoqué dans le Death Duel de Chu Yuan. La subtilité n’est de toutes manières pas un art que Stephen Chow cultive, comme en témoigne le lourd symbole de la chenille, qui était déjà bien assez parlant sans qu’on ajoute un plan de papillon s’envolant. Mais qu’importe, tous les partis-pris sont assumés, et cette flamboyance, cette énergie, sont les éléments qui font de Kung Fu Hustle une œuvre touchante et attachante. L’ambition est grande, les moyens aussi, la technique bonne, mais avant toute chose, c’est une œuvre de cœur, et cela se sent. Quand le générique retentit, on a l’impression d’avoir revécu, le temps d’un film, toute une époque. On regrettera que la star se fasse de plus en plus discrète, mais peut-être Stephen Chow a-t-il raconté tout ce qu’il avait à dire ?
|
 |
 |
Léonard Aigoin 2/23/2011 - haut |
 |
 |
Shaolin (2010) |
 |
 |

 Andy Lau est un seigneur de la guerre cruel et sans pitié. Mais le jour où il est trahi par un jeune officier ambitieux (Nicholas Tse), la tragédie l'oblige à se réfugier à Shaolin, où il va rencontrer des êtres purs, comme un moine cuisinier (Jackie Chan), et surtout apprendre l'humilité et l'humanité. Mais cet apprentissage ne serait peut-être pas suffisant pour empêcher la destruction du temple. Andy Lau est un seigneur de la guerre cruel et sans pitié. Mais le jour où il est trahi par un jeune officier ambitieux (Nicholas Tse), la tragédie l'oblige à se réfugier à Shaolin, où il va rencontrer des êtres purs, comme un moine cuisinier (Jackie Chan), et surtout apprendre l'humilité et l'humanité. Mais cet apprentissage ne serait peut-être pas suffisant pour empêcher la destruction du temple.
 Les fans de films d’arts martiaux ont souvent entendu parler de « films de karaté », une appellation relativement agaçante. Mais même le grand public, qui pense que les pratiquants d’arts martiaux sont tous des karatékas, a une idée plus ou moins précise de ce que représente Shaolin. Au cinéma, il y eut un véritable engouement pour les arts martiaux de Shaolin au milieu des années 70, quand Lau Kar Leung conseilla au réalisateur Chang Cheh de s’emparer du sujet. Et l’Ogre de Hong Kong a justifié son surnom en manifestant un appétit démesuré pour les fameux moines, et en particulier les conséquences de la destruction du temple. Et si ces œuvres mettent davantage l’action sur le côté spectaculaire et l’héroïsme forcené, Lau Kar Leung, une fois passé à la réalisation, s’est fait le représentant le plus mémorable de la philosophie de Shaolin, dont il est un descendant direct. Mais la disparition des films d’arts martiaux purs a annoncé le déclin du cycle Shaolin, et même avec l’explosion des kung fu câblés, le temple n’a pas connu de nouvelle jeunesse cinématographique. L’annonce d’un projet dédié au sujet par Benny Chan ne pouvait donc qu’interpeller. Le réalisateur s’est montré particulièrement ambitieux ces dernières années, et il a réuni pour l’occasion un casting alléchant. Andy Lau n’est pas un authentique pratiquant, ce qui ne l’a pas empêché de débuter sa carrière comme action star, enchaînant les tournages énergiques dans des rôles de combattant émérite. Ce Shaolin signe son retour dans un rôle plutôt physique, après The Warlords, dans lequel il ne se battait finalement que peu. Face à lui, Nicholas Tse, qui a acquis une certaine expérience d’acteur physique, et qui pour une fois incarne une belle ordure. Car Benny Chan mélange les générations, et s’offre les services de stars aussi bien que de seconds rôles qui ont su marquer les années 90 par leur présence. Enfin, la participation de Corey Yuen Kwai et Yuen Tak aux chorégraphies donne une légitimité martiale à une œuvre qu’on attend tout de même davantage pour ses combats que pour son histoire. Les fans de films d’arts martiaux ont souvent entendu parler de « films de karaté », une appellation relativement agaçante. Mais même le grand public, qui pense que les pratiquants d’arts martiaux sont tous des karatékas, a une idée plus ou moins précise de ce que représente Shaolin. Au cinéma, il y eut un véritable engouement pour les arts martiaux de Shaolin au milieu des années 70, quand Lau Kar Leung conseilla au réalisateur Chang Cheh de s’emparer du sujet. Et l’Ogre de Hong Kong a justifié son surnom en manifestant un appétit démesuré pour les fameux moines, et en particulier les conséquences de la destruction du temple. Et si ces œuvres mettent davantage l’action sur le côté spectaculaire et l’héroïsme forcené, Lau Kar Leung, une fois passé à la réalisation, s’est fait le représentant le plus mémorable de la philosophie de Shaolin, dont il est un descendant direct. Mais la disparition des films d’arts martiaux purs a annoncé le déclin du cycle Shaolin, et même avec l’explosion des kung fu câblés, le temple n’a pas connu de nouvelle jeunesse cinématographique. L’annonce d’un projet dédié au sujet par Benny Chan ne pouvait donc qu’interpeller. Le réalisateur s’est montré particulièrement ambitieux ces dernières années, et il a réuni pour l’occasion un casting alléchant. Andy Lau n’est pas un authentique pratiquant, ce qui ne l’a pas empêché de débuter sa carrière comme action star, enchaînant les tournages énergiques dans des rôles de combattant émérite. Ce Shaolin signe son retour dans un rôle plutôt physique, après The Warlords, dans lequel il ne se battait finalement que peu. Face à lui, Nicholas Tse, qui a acquis une certaine expérience d’acteur physique, et qui pour une fois incarne une belle ordure. Car Benny Chan mélange les générations, et s’offre les services de stars aussi bien que de seconds rôles qui ont su marquer les années 90 par leur présence. Enfin, la participation de Corey Yuen Kwai et Yuen Tak aux chorégraphies donne une légitimité martiale à une œuvre qu’on attend tout de même davantage pour ses combats que pour son histoire.
Et dès les premières images, on constate que Benny Chan a eu à cœur de faire de son Shaolin plus qu’une simple série B. Les paysages naturels dévastés et recouverts de boue ne sont d’ailleurs pas sans rappeler le travail effectué sur The Warlords de Peter Chan. La crasse, le temps, les cadavres qui jonchent le sol, tout est fait pour créer un contexte historique réaliste, dénonçant les conditions de vie chaotiques de l’époque, et les abus dont étaient victimes les petites gens. Le réalisateur donne d’ailleurs beaucoup d’ampleur à sa mise en scène, grâce à une caméra presque toujours en mouvement. L’alternance systématique de mouvements de grue ascendants puis descendants, ainsi que son recours répété aux plongées, permet de s’immerger de façon spectaculaire dans le récit, même si cette technique finit par être redondante. Tout en étant visuellement efficace, elle rappelle, dans l’esprit, l’emploi excessif de zooms dans les films de Chang Cheh mettant en scène les Venoms. Visuellement, entre des décors de qualité et une réalisation aussi soignée que dynamique, l’ensemble est plutôt convaincant. Le fameux temple semble peu étendu, mais reste plutôt bien exploité. Seule une montagne qui verra une poursuite épique se dérouler peine à convaincre, à cause d’une impression irritante de carton pâte. Car sans être un road movie, Shaolin nous fait voir du paysage pendant sa première moitié, et tant le temple que les moines sont réduits à de la figuration, sans rapport direct avec l’histoire. Car c’est bien le destin de Hou, incarné par Andy Lau qui nous est conté. Ce dernier trouve un rôle à la mesure de son talent, dont il nous démontre l’étendue. Nicholas Tse nous prouve à quel point il est aisé de surjouer les chefs militaires mégalomanes et cruels. Mais Andy parvient à éviter cet écart, et si l’évolution psychologique de son personnage était plus convaincante sur le papier, Hou serait réellement mémorable. En l’état, la star nous rappelle qu’il est un véritable acteur, et en quelques regards, il parvient à exprimer tellement d’émotion qu’on constate à quel point son potentiel n’est pas toujours exploité à sa juste valeur. Sa première scène est très représentative, car on ressent la menace qu’il représente en même temps que certains de ses comportements rassurent. L’ambivalence de son attitude est parfaitement rendue, et malgré l’ignominie de ses actes, on s’attache rapidement à cet homme complexe. Néanmoins, ses remords et sa remise en question sont basés sur une facilité scénaristique qui les rend peur intéressants. De plus, son cheminement n’est pas du tout développé, et la rencontre avec Shaolin reste trop artificielle.
Pourtant, on était en droit d’attendre une découverte approfondie des traditions Shaolin, lorsque notre héros rencontre le cuisinier incarné par Jackie Chan. Mais Benny Chan reste en surface, racontant une histoire dont les enjeux restent limités. C’est d’autant plus regrettable que d’autres réalisateurs nous ont montré tout le potentiel cinématographique du temple, or ici, tant les entraînements que l’élévation spirituelle restent anecdotiques. La fameuse attaque finale est également traitée de façon surprenante. Pas tout à fait intimiste comme elle l’aurait pu l’être, mais n’insistant pas réellement non plus sur la bataille monumentale, c’est finalement la conclusion qui permet de constater l’étendue du conflit. Comme si Benny Chan avait une grande quantité d’idées, mais les oubliait au fur et à mesure, pour y revenir ensuite. Ainsi dans la deuxième heure, le personnage d’Andy Lau, tout en restant le héros, reste curieusement en retrait. Il est dit qu’il a dépassé les sentiments de haine ou de vengeance, mais il semble ne plus être qu’une coquille vide. C’est d’autant plus regrettable que l’acteur s’investit beaucoup et que son jeu est très juste. Mais n’aurait-il pas été plus pertinent d’explorer davantage ses tourments, en insistant sur son ambivalence ? A ce titre, Hou peut rappeler le Wu Lang interprété par Gordon Liu dans Eight Diagram Pole Fighter, non seulement parce que leurs destins présentent des similitudes, mais aussi parce qu’une scène en particulier vient faire écho à l’œuvre de Liu Chia-Liang. Mais Andy se coupant les cheveux avec un ciseau a un impact émotionnel moins important que le rasage de crâne de Gordon Liu, à cause d’une réalisation soignée mais trop contrôlée, trop précise. Et c’est bien là le problème de ce Shaolin : la simplicité de l’histoire aurait été bien plus facile à accepter si le réalisateur était parvenu à nous investir dans son récit. Mais l’élégance de sa mise en scène est trop calculée. La recherche esthétique n’est d’ailleurs pas toujours un gage de réussite, on pestera par exemple de retrouver l’utilisation de teintes sépias dans un flashback, procédé cliché auquel Chan semble tenir. Mais tout ce travail n’est pas inutile, et quelques scènes en particulier restent très marquantes. A ce titre, l’utilisation du ralenti n’est pas excessive, et sert généralement le propos. La montée d’escalier précédant le traquenard bénéficie ainsi d’une formidable montée en tension, et cette anticipation donne beaucoup plus d’impact à la scène. De même, l’entraînement en binôme d’Andy et d’un enfant moine est filmé avec une grâce tout à fait pertinente dans le contexte, et le ralenti accompagne élégamment une musique appropriée. Ce qui n’est pas toujours le cas, la bande originale oscillant entre mélodies puissantes et morceaux mièvres, même si ces derniers sont moins nombreux. Ainsi, malgré cette sensation de contempler une œuvre un peu froide, il y a une véritable unité dans Shaolin.
Affirmation qu’on peut remettre en question lorsqu’on évoque le jeu des acteurs. Si Andy Lau se montre très convaincant, Nic Tse rate une occasion d’interpréter un antagoniste marquant. Il faut dire que le rôle est mal écrit et ne dépasse pas le classique traître cruel. Jacky Wu Jing confirme que la sobriété tout à fait bienvenue qu’il manifestait dans City Under Siege lui convient très bien, malheureusement, il n’est présent pas plus de 10 minutes à l’écran. Et c’est bien dommage car il donne beaucoup d’humanité à ce moine impulsif et très humain. Les personnages féminins sont également gâchés, et ce n’est pas Fan Bing Bing qui va contredire ce constat. Il aurait été aisé d’en faire un rôle marquant, mais elle n’est qu’une coquille vide, interprétée sans conviction de surcroit. La surprise vient finalement de Jackie Chan. Sans être la star, il est bien plus présent à l’écran qu’on pourrait le croire, et nous rappelle à quel point il peut être charismatique. On a un peu l’impression de voir ce que serait devenu son personnage de Little Big Soldier s’il avait été recueilli au temple dans l’enfance. Chan se montre plus attachant que jamais et joue avec beaucoup de naturel un rôle simple mais touchant. Chacune de ses apparitions est un vrai plaisir, et il s’illustre même dans un combat très réussi. Du point de vue martial, Shaolin propose quelques échanges spectaculaires. Le rythme n’est pas démentiel, puisque la première heure ne compte qu’un combat d’introduction et un traquenard. Ce dernier est par contre enthousiasmant. Il n’y a pas de véritable échange martial, mais quelques coups spectaculaires, et surtout une série de poursuites vraiment immersives. Mais il faudra attendre la dernière partie du film pour assister à une succession d’affrontements pas si longs qu’on pourrait le croire, mais déjà plus consistants. Jacky Wu Jing aura l’occasion de s’offrir sa scène digne d’un film de Chang Cheh, même s’il ne combat que trop peu, et l’action sera au centre du récit à partir de ce moment. Le gros final est moins dantesque qu’on aurait pu le croire. Le nombre de figurants se battant est bien moins important que prévu, et finalement, l’accent est mis sur les duels. Hung Yan Yan nous montre d’ailleurs qu’il bouge encore très bien, dans un échange de coups de sabre mémorable avec Xing Yu, qui n’est pas sans rappeler les grands moments des wu xia pian des années 90. Le combat entre Nic Tse et Andy est également très bon, même si bien trop court. C’est d’ailleurs la règle dans ce Shaolin, les combats ne durent jamais aussi longtemps qu’on l’aimerait. Pourtant, les chorégraphes ont fait un travail remarquable, et le montage est très bon, restant toujours lisible, tout en insufflant un dynamisme qui manque ces dernières années ! Reste que le climax accomplit sa mission : en mettre plein la vue, entre des duels martiaux de toute beauté et des explosions bruyantes, avant de finir sur un boom !
Avec Shaolin, Benny Chan compense City Under Siege, et livre un produit de qualité, qui devrait satisfaire les amateurs d’action. Mais il confirme également que s’il est un très bon artisan, il manque une âme à son travail, et c’est bien dommage.
|
 |
 |
Léonard Aigoin 2/9/2011 - haut |
 |
 |
Spy Next Door (2010) |
 |
 |

 Un homme est appelé pour garder les enfants de son voisin et fini par devoir se battre contre des agents secrets après qu'un des enfants ait téléchargé par inadvertance un code secret. (allocine.com) Un homme est appelé pour garder les enfants de son voisin et fini par devoir se battre contre des agents secrets après qu'un des enfants ait téléchargé par inadvertance un code secret. (allocine.com)
 Les stars de film d’action semblent souvent ressentir le besoin d’exprimer leur potentiel de père. Il n’est pas rare de voir des acteurs habitués aux rôles musclés se confronter à des enfants dans ces comédies familiales. Arnold Schwarzeneger s’était ainsi illustré en brute au grand cœur dans le Un Flic A La Maternelle de Ivan Reitman au début des années 90. Les années 2000 ont été l’occasion pour d’autres noms de l’action de se retrousser les manches pour affronter des bambins facétieux. On pense à Vin Diesel dan Baby Sittor en 2004, ou encore à Dwayne Johnson, plus connu sous l’alias « The Rock », qui a joué dans Fée Malgré Lui en 2010. Difficile de prétendre que ces œuvres témoignent d’une grande ambition, et quelque aient pu être leurs résultats au box office, leurs qualités artistiques restent encore à démontrer. Ainsi, l’annonce de The Spy Next Door, retitré Kung Fu Nanny chez nous, avait de quoi décontenancer, et même effrayer, les amateurs des films avec Jackie Chan. La star a fait des choix décevants au cours de sa carrière Hollywoodienne, et il est à peu près certain que la majorité de ses fans préfèrent les films qu’il tourne à Hong Kong, aujourd’hui encore. Mais jusque-là, Chan, tout en se confinant dans le genre de la comédie familiale, avait tenté de satisfaire ceux qui veulent le voir en action. Or l’année 2010 semble être l’occasion pour la star de renforcer sa résolution à faire rire toute la famille, et ici les plus jeunes. Et ce n’est pas la bande annonce enfantine (sur laquelle on imagine bien la fameuse chanson des frères Hanson) qui viendra contredire cette impression que Chan courtise un public de plus en plus jeune. Pourtant, malgré tout ce qu’on peut dire sur lui, il y a cette espèce de fidélité du fan, qui se sent presque obligé de voir tous les films mettant en scène l’acteur, même en étant persuadé que le divertissement risque d’être gênant, et on se retrouve à foncer tête baissée, en pensant qu’il y aura bien quelques gags, quelques chorégraphies, ou le charisme de Jackie, pour sauver l’heure et demie à venir ! Les stars de film d’action semblent souvent ressentir le besoin d’exprimer leur potentiel de père. Il n’est pas rare de voir des acteurs habitués aux rôles musclés se confronter à des enfants dans ces comédies familiales. Arnold Schwarzeneger s’était ainsi illustré en brute au grand cœur dans le Un Flic A La Maternelle de Ivan Reitman au début des années 90. Les années 2000 ont été l’occasion pour d’autres noms de l’action de se retrousser les manches pour affronter des bambins facétieux. On pense à Vin Diesel dan Baby Sittor en 2004, ou encore à Dwayne Johnson, plus connu sous l’alias « The Rock », qui a joué dans Fée Malgré Lui en 2010. Difficile de prétendre que ces œuvres témoignent d’une grande ambition, et quelque aient pu être leurs résultats au box office, leurs qualités artistiques restent encore à démontrer. Ainsi, l’annonce de The Spy Next Door, retitré Kung Fu Nanny chez nous, avait de quoi décontenancer, et même effrayer, les amateurs des films avec Jackie Chan. La star a fait des choix décevants au cours de sa carrière Hollywoodienne, et il est à peu près certain que la majorité de ses fans préfèrent les films qu’il tourne à Hong Kong, aujourd’hui encore. Mais jusque-là, Chan, tout en se confinant dans le genre de la comédie familiale, avait tenté de satisfaire ceux qui veulent le voir en action. Or l’année 2010 semble être l’occasion pour la star de renforcer sa résolution à faire rire toute la famille, et ici les plus jeunes. Et ce n’est pas la bande annonce enfantine (sur laquelle on imagine bien la fameuse chanson des frères Hanson) qui viendra contredire cette impression que Chan courtise un public de plus en plus jeune. Pourtant, malgré tout ce qu’on peut dire sur lui, il y a cette espèce de fidélité du fan, qui se sent presque obligé de voir tous les films mettant en scène l’acteur, même en étant persuadé que le divertissement risque d’être gênant, et on se retrouve à foncer tête baissée, en pensant qu’il y aura bien quelques gags, quelques chorégraphies, ou le charisme de Jackie, pour sauver l’heure et demie à venir !
Le générique d’introduction vient d’ailleurs jouer sur nos sentiments, en utilisant la fameuse chanson "Secret Agent Man", popularisé par Johnny Rivers et remise au goût du jour par David Hasselhoff. Et pour accompagner cet air bien connu, des images de Rush Hour 2, The Tuxedo, et surtout Opération Condor, censées évoquer les aptitudes hors du commun de notre fameux espion. On peut légitimement se demander la pertinence d’un tel générique : est-il destiné à nous faire penser que The Spy Next Door est la suite de ces films ? Vient-il appuyer l’idée que Jackie Chan est un personnage à part entière, qui dépasse les rôles qu’il incarne ? Ou s’agit-il juste d’une stratégie mercantile destinée à donner un coup de coude complice dans les côtes des fans ? Toujours est-il que cette ambiance survoltée va rapidement céder la place à la comédie familiale dans tout ce qu’elle a de plus nuisible : des enfants et des animaux hurlant sur fond de musique pataude d’ascenseur. Et rapidement, l’aspect propret va agacer. Entre une mère mannequin pour catalogue de prêt-à-porter, des enfants tout beaux tout gentils, et une maison témoin, tout sonne faux. Et ce n’est pas le « scénario », aussi convenu qu’ennuyeux qui va supprimer cette ambiance factice. Comment se laisser convaincre par le couple formé par miss monde et un Jackie mal fagoté, censé être un ennuyeux vendeur de stylos ? D’ailleurs, il n’y a aucune étincelle entre les deux acteurs, et on sera soulagé de ne pas les voir partager l’écran bien longtemps. Car si Clark Kent et ses lunettes ont moins de style que Superman et sa cape, Jackie avec ou sans lunettes n’a rien d’un playboy. Toujours est-il que la disparition de la mère Barbie va justifier le titre français, puisque notre héros va passer la plus grande partie du métrage à s’occuper d’enfants méchants tout plein. Car après avoir affrontés des gangsters, des espions internationaux, des spécialistes des arts martiaux et toutes sortes d’ennemis plus ou moins invincibles, on voudrait nous faire croire que 3 enfants de banlieue chic constituent la pire menace qu’un petit chinois spécialiste des arts martiaux ait jamais rencontrée ?
Si encore Jackie nous avait fait son Boyz In The Hood, on aurait pu concevoir qu’il rencontre suffisamment de difficultés pour occuper une bonne heure de film. Mais la rébellion des enfants de The Spy Next Door consiste à lancer des boules puantes et à réclamer qu’on sorte de leur chambre. C’est à se demander si le scénariste a déjà rencontré un enfant. Un vrai, pas un en plastique. Mais après tout, c’est une comédie, et non un récit sociologique sur les conséquences du divorce. Et tout le monde sait qu’un espion qui utilise une caméra et un micro pour dire à une adolescente de mettre une jupe plus longue est hilarant. En fait, The Spy Next Door aurait pu se contenter de ne pas être drôle. Mais il parvient même à devenir gênant, tant l’humour est bas de gamme. Car les scènes mettant en scène les méchants russes et leur méchant accent sont encore plus grotesques que les traquenards avec les enfants. Le gag récurrent du costume n’est déjà pas drôle la première fois, alors la quatrième fois, il faut lutter pour ne pas arrêter le visionnage. Sans compter que l’inconsistance du scénario ne s’arrête pas aux scènes « comiques ». Comment expliquer cette première scène d’action, durant laquelle Jackie intervient seul pour stopper un groupe d’individus, alors qu’une escouade entière est prête à les interpeller ? De même, on ne peut que se demander pourquoi les fameux gangsters russes (et leur accent) ne sont que 3 sur les lieux (dont le chef, en tout logique), quand on découvrira plus tard qu’ils sont une bonne dizaine (ce qui reste peu pour une organisation dont l’envergure est censée être internationale) ? Les passages concernant la CIA sont tout aussi risibles, et on a bien du mal à croire tant à leurs procédures qu’à leur façon de travailler en général. Sans compter qu’un individu comme le père de Miley Cyrus ne serait jamais accepté comme agent, il est bien trop connu !
Cette première heure est d’autant plus difficile à supporter qu’il n’y a qu’une scène d’action. Très courte, et sans éclat, elle est malgré tout supérieur aux affrontements de The Tuxedo. Mais Jackie n’a plus 20 ans, et au lieu d’adapter les affrontements à sa forme actuelle, comme dans Karate Kid, il est censé effectuer des acrobaties, comme au bon vieux temps. Seulement, le temps n’est pas le seul à être vieux, et le recours systématique à une doublure ne légitime pas ce choix de chorégraphies. Et pourtant, il ne doit pas y avoir plus de 5 minutes de combat dans The Spy Next Door, et le niveau est d’une médiocrité effrayante. On sent bien que ce n’est pas l’intérêt du film, mais il est difficile de ne pas être déçu quand la star continue d’être vendue sur cet argument. Le dernier tiers du film se veut d’ailleurs plus proche du road movie mâtiné d’action que de la comédie familiale pure, mais il n’y a aucun passage suffisamment marquant pour faire sortir du caniveau un divertissement qui n’atteindra jamais le trottoir. Outre ce manque de spectacle et la nullité de l’humour, on pestera contre les clichés les plus surannés du genre. La fin est une merveille de mièvrerie prévisible et agaçante, et quand enfin vient le générique, on se sent libéré. Jackie Chan n’a pas joué que dans des bons films, mais il a franchi une limite qu’on espère ne plus jamais le voir approcher. The Spy Next Door est un ratage à tous les niveaux, même en étant bon public, et il est donc vivement déconseillé.
|
 |
 |
Léonard Aigoin 2/7/2011 - haut |
 |
 |
Tuxedo (2001) |
 |
 |

 Jimmy Tong est un chauffeur ordinaire qui, après s'être glissé dans un smoking de superespion de 2 milliards de dollars, devient malgré lui un agent secret sensationnel. Ce smoking de luxe plonge le pauvre Tong et son éblouissante partenaire Del Blaine dans l'univers dangereux de l'espionnage international. Jimmy Tong est un chauffeur ordinaire qui, après s'être glissé dans un smoking de superespion de 2 milliards de dollars, devient malgré lui un agent secret sensationnel. Ce smoking de luxe plonge le pauvre Tong et son éblouissante partenaire Del Blaine dans l'univers dangereux de l'espionnage international.
 Lorsqu’il entame le tournage de The Tuxedo en 2001, Jackie Chan a réalisé le rêve américain, grâce au succès de Rush Hour, obtenant ainsi la reconnaissance à laquelle il aspirait depuis des années. Mais après s’être illustré comme star des films d’action, il espère remporter l’adhésion en tant qu’acteur à part entière. Ainsi, il annonce lors de la promotion du film qu’il espère mettre en valeur ses talents dramatiques. Or, pour le public occidental, il semble que le seul rôle que puisse jouer un acteur asiatique est celui d’un petit homme adepte d’arts martiaux, venu démontrer sa maîtrise du combat tout en se perdant dans une culture qui lui est inconnue. Comment, dans un tel contexte, développer un personnage suffisamment fort pour s’investir du point de vue dramatique ? Tout simplement en interprétant un monsieur tout le monde. Mais quand Jackie Chan ne joue pas les superflics, il est un habitué du type qui se trouve au mauvais endroit au mauvais moment, mais qui parvient tout de même à se débarrasser des criminels. Afin de s’éloigner de ce modèle, la star va incarner Jimmy Tong, petit conducteur de taxi timide et surtout incapable de se défendre, que rien ne destine à devenir un héros. Et comme la recette du buddy movie s’est révélée fructueuse dans Rush Hour et dans Shanghai Kid, Chan va une fois de plus partager l’écran avec une vedette américaine. Mais cette fois, ce n’est pas un blablateur ou un petit escroc qui va venir semer la zizanie, mais une jeune scientifique qui dispose de sérieux atouts pour ne pas laisser notre homme de la rue indifférent. Si à cette époque, Chan est déjà une star à la renommée mondiale, toute l’équipe n’a pas le même palmarès. Jennifer Love-Hewitt a une carrière bien remplie, entre sitcoms et films pour adolescents, sans pouvoir être considérée comme un grand nom, et le réalisateur Kevin Donovan n’a tourné que quelques clips. Seuls Jason Isaacs et Peter Stormare peuvent réellement justifier d’un palmarès impressionnant, mais leurs rôles sont réduits à de courtes apparitions. Ainsi The Tuxedo reste porté par son duo principal, les deux acteurs s’étant investi rigoureusement dans le tournage. Lorsqu’il entame le tournage de The Tuxedo en 2001, Jackie Chan a réalisé le rêve américain, grâce au succès de Rush Hour, obtenant ainsi la reconnaissance à laquelle il aspirait depuis des années. Mais après s’être illustré comme star des films d’action, il espère remporter l’adhésion en tant qu’acteur à part entière. Ainsi, il annonce lors de la promotion du film qu’il espère mettre en valeur ses talents dramatiques. Or, pour le public occidental, il semble que le seul rôle que puisse jouer un acteur asiatique est celui d’un petit homme adepte d’arts martiaux, venu démontrer sa maîtrise du combat tout en se perdant dans une culture qui lui est inconnue. Comment, dans un tel contexte, développer un personnage suffisamment fort pour s’investir du point de vue dramatique ? Tout simplement en interprétant un monsieur tout le monde. Mais quand Jackie Chan ne joue pas les superflics, il est un habitué du type qui se trouve au mauvais endroit au mauvais moment, mais qui parvient tout de même à se débarrasser des criminels. Afin de s’éloigner de ce modèle, la star va incarner Jimmy Tong, petit conducteur de taxi timide et surtout incapable de se défendre, que rien ne destine à devenir un héros. Et comme la recette du buddy movie s’est révélée fructueuse dans Rush Hour et dans Shanghai Kid, Chan va une fois de plus partager l’écran avec une vedette américaine. Mais cette fois, ce n’est pas un blablateur ou un petit escroc qui va venir semer la zizanie, mais une jeune scientifique qui dispose de sérieux atouts pour ne pas laisser notre homme de la rue indifférent. Si à cette époque, Chan est déjà une star à la renommée mondiale, toute l’équipe n’a pas le même palmarès. Jennifer Love-Hewitt a une carrière bien remplie, entre sitcoms et films pour adolescents, sans pouvoir être considérée comme un grand nom, et le réalisateur Kevin Donovan n’a tourné que quelques clips. Seuls Jason Isaacs et Peter Stormare peuvent réellement justifier d’un palmarès impressionnant, mais leurs rôles sont réduits à de courtes apparitions. Ainsi The Tuxedo reste porté par son duo principal, les deux acteurs s’étant investi rigoureusement dans le tournage.
Il est difficile, dans un premier temps, de déterminer le propos. Ce n’est pas ce plan sur un faon urinant dans une rivière qui va permettre de corroborer les déclarations de Jackie Chan sur le contenu dramatique du récit. Et si le registre de l’espionnage est abordé, c’est davantage avec un second degré amusé qu’un sérieux inquiétant, malgré certaines scènes de meurtre. Les ambitions de The Tuxedo semblent finalement très proches des autres productions Hollywoodiennes dans lesquelles la star a joué, puisque tout ne sachant pas se battre, son personnage est un petit chinois sauteur qui bondit sur les toits des voitures pour échapper à des assaillants agacés par sa maladresse. Dans un premier temps, l’intrigue va donc alterner les scènes expliquant la menace qui pèse sur le monde, en présentant un businessman aux valeurs peu humanistes, et celles développant le destin de cet amoureux transi de Jackie, incapable d’adresser la parole à une femme. Et quand sa rencontre avec un agent secret riche, chic et sympathique donne l’impression d’assister à une sorte d’adaptation de The Green Hornet, tout ce qui avait établi jusque-là va être bouleversé pour permettre à l’histoire de réellement démarrer. Il existe d’ailleurs un véritable paradoxe entre la longueur de cette introduction de 30 minutes, et la façon très succincte de présenter certains éléments. On regrettera en particulier le manque de temps dédié à l’approfondissement des relations entres les différents protagonistes, dont les caractéristiques restent particulièrement superficielles. Et même si Jackie espère développer ses talents dramatiques, ce n’est pas son personnage peu intéressant de chinois qui ne sait pas se battre, mais qui va quand même se battre comme un dieu qui va lui permettre de promouvoir cette image de véritable acteur qui lui importe tant.
Car ce qu’on retiendra de sa prestation, c’est sa propension à sourire constamment, le caractère bonhomme et naïf de son Jimmy Tong, et sa maladresse qui le conduit toujours dans les pires situations. Des éléments qu’on trouve dans une grosse majorité de ses films. Le reste de la filmographie de l’acteur prouve sa sincère volonté de se détacher de l’image qu’il s’est créée, autant que sa crainte de le faire. Mais indépendamment de ses projets, il est certain que les producteurs américains doivent être frileux à l’idée de laisser une star dont l’image a un poids indéniable dans le succès de ses films, changer la formule de son succès. On s’étonnera malgré tout du faible temps imparti pour les scènes d’action. On avait déjà pu constater dans le premier Rush Hour que les critères américains, au moins en termes de durée des scènes, n’étaient pas les mêmes que ceux des productions de Hong Kong, mais Shanghai Kid semblait avoir rectifié le tir. Or, pour The Tuxedo, les affrontements sont encore moins nombreux et moins longs que dans le film de Brett Ratner. Il faudra ainsi attendre près de trois quart d’heure avant de voir le héros en action. Chan réutilise dans cette scène l’une des chorégraphies de Big Brother impliquant une corde, mais il la simplifie nettement, sans doute parce qu’il ne disposait pas d’assez de temps pour livrer un résultat aussi élaboré qu’à l’accoutumée. On aura droit à un autre combat, encore plus court, qui insiste d’ailleurs sur le côté très cartoon du concept du film. Car considérer The Tuxedo comme un film d’action serait une erreur. Les quelques affrontements ne sont là que pour justifier la présence de Jackie Chan, et les formidables capacités du smoking auraient tout aussi bien pu être exploitées autrement, comme de nombreux exemples du film l’illustrent. On en vient d’ailleurs à questionner la légitimité d’un duel final qui semble vraiment gratuit, tant aucun élément ne vient le préparer. Le costume n’est en effet qu’un artifice dans l’histoire, qui n’a finalement pas de réelle justification scénaristique. On pourrait tout à fait imaginer un récit presque identique, dans lequel Chan aurait tout simplement incarné un petit chinois qui sait naturellement se battre, et aurait donc eu les capacités naturelles pour enquêter comme il le fait. Bien sûr, les pouvoirs conférés par le smoking donnent lieu à quelques scènes sympathiques, comme la fameuse rencontre avec James Brown, ou quelques cascades assez amusantes, mais concrètement, aucun passage ne fait du costume autre chose qu’un gadget.
Et ce n’est pas un final dans lequel l’exploitation du costume n’a qu’une faible influence qui viendra contredire ce constat. Car malgré un potentiel évident, le combat de fin est expédié avec une telle rapidité qu’on n’a même pas le temps de profiter de la chorégraphie. Mais une fois encore, il semble que ce ne soit pas le centre d’intérêt du réalisateur, qui préfère filmer les à côtés que les affrontements en eux-mêmes. Le temps accordé à la chorégraphie semble d’ailleurs de plus en plus court, à tel point que plusieurs plans sont quasiment identiques. En tant que film d’action, The Tuxedo est donc une déception, et on ne peut que regretter que Chan n’ait pas davantage l’occasion de s’exprimer physiquement, même s’il donne de sa personne dans des scènes de danse endiablées. Pourtant, on ne peut pas dire qu’on s’ennuie. L’humour bon enfant ne provoque pas l’hilarité, mais l’enchaînement des scènes procure un rythme suffisamment élevé pour qu’on ne ressente pas le besoin de consulter sa montre. Le duo Chan/Hewitt fonctionne par moments, sans réellement convaincre. Les deux acteurs s’investissent, mais on ne ressent pas de réelle alchimie entre leurs personnages malheureusement. La dynamique entre Chan et Jason Isaacs était plus amusante, mais elle ne sera que peu exploitée. La distinction entre les deux est par contre bien mise en valeur dans une scène d’espionnage qui clôt le récit avec humour, et se présente même comme le passage le plus amusant. La réalisation y est plus dynamique, le montage singe habilement les clichés inhérents aux séries tv actuelles, et la séquence est en tel décalage avec le contexte qu’on se prend vite à sourire. Et finalement, c’est ça la force de The Tuxedo : réussir à donner le sourire tout en n’étant pas vraiment conforme à ce qu’on pouvait attendre.
Il ne s’agit pas réellement d’un film d’action, pas réellement d’un film d’espionnage, il n’y a pas de gros passage dramatique comme Jackie Chan l’espérait, et on ne rit pas aux éclats. Pourtant, il y a un côté communicatif à l’enthousiasme de l’équipe, et si on cherche juste un petit divertissement sans prétention, on peut tout à fait passer un bon moment devant The Tuxedo.
|
 |
 |
Léonard Aigoin 1/31/2011 - haut |
 |
 |
Shadow : Dead Riot (2005) |
 |
 |

 Si les zombies sont connus depuis l’ouvrage d’anthropologie "Magic Island" publié en 1929, et qu’un certain nombre de films (le plus célèbre étant White Zombie, avec Bela Lugosi), il aura tout de même fallu attendre Night Of The Living Dead de George A. Romero en 1968 pour les voir passer du statut de faire valoir mystérieux à celui de mythe terrorisant. Mais avec les années, l’horreur a laissé sa place aux rires. Outre les comédies telles que Shaun Of The Dead ou Zombieland, dont l’humour est destiné à rendre les morts-vivants divertissants pour le grand public (même si dans le cas du film britannique, il n’y a pas vraiment de concessions sur le plan visuel), une grosse majorité de l’industrie des films à petit budget s’est inscrite dans cette vision. En effet, l’humour est un bon moyen de ne pas interpeller le spectateur à la vue d’effets spéciaux risibles ou de faux raccords : après tout, on ne se prend pas au sérieux ! Ce parti-pris fait donc la joie des réalisateurs qui a défaut d’en avoir le talent, en ont le titre. Le film de zombies peut donc tout autant être une usine à talents, désireux de s’illustrer par leur ingéniosité, au-delà d’un budget dérisoire, qu’une opportunité mercantile de retirer un petit bénéfice d’une « œuvre » faite à la va-vite. A la vue de ce Shadow : Dead Riot, on est d’ailleurs vite tenté de le situer dans cette catégorie de divertissements. L’affiche ressemble en effet plus à une sorte d’avertissement invitant le spectateur à détourner son chemin qu’à un aperçu éveillant l’intérêt. Derek Wan ne s’étant jusque-là illustré qu’en tant que directeur de la photographie dans des productions hongkongaises (et en tant que metteur en scène de deux téléfilms), on envisage cette expérience comme un entraînement, plus que comme la mise en images d’un récit avec une vision. Et pour pallier le manque de poids de son nom, on lui octroie deux vedettes d’un cinéma autre, Tony Todd, qui a connu la gloire dans Candy Man (et qui a déjà eu l’occasion de partager l’écran avec des goules dans le remake de Night Of The Living Dead, par Tom Savini), et Misty Mundae, actrice qui a réussi à se faire un nom dans le cinéma indépendant tendance trash. Or, la présence de ces « grands » noms ne garantit pas, comme on peut s’en douter, un budget confortable. L’actrice principale a une carrière bien plus modeste, même si elle a fait de la figuration dans Inside Man de Spike Lee. Mais la grande surprise de ce Shadow : Dead Riot se situe dans son générique, qui annonce fièrement la présence de Tony Leung Siu Hung au poste de chorégraphe des scènes d’action. Serait-on dans un film d’arts martiaux ? Si les zombies sont connus depuis l’ouvrage d’anthropologie "Magic Island" publié en 1929, et qu’un certain nombre de films (le plus célèbre étant White Zombie, avec Bela Lugosi), il aura tout de même fallu attendre Night Of The Living Dead de George A. Romero en 1968 pour les voir passer du statut de faire valoir mystérieux à celui de mythe terrorisant. Mais avec les années, l’horreur a laissé sa place aux rires. Outre les comédies telles que Shaun Of The Dead ou Zombieland, dont l’humour est destiné à rendre les morts-vivants divertissants pour le grand public (même si dans le cas du film britannique, il n’y a pas vraiment de concessions sur le plan visuel), une grosse majorité de l’industrie des films à petit budget s’est inscrite dans cette vision. En effet, l’humour est un bon moyen de ne pas interpeller le spectateur à la vue d’effets spéciaux risibles ou de faux raccords : après tout, on ne se prend pas au sérieux ! Ce parti-pris fait donc la joie des réalisateurs qui a défaut d’en avoir le talent, en ont le titre. Le film de zombies peut donc tout autant être une usine à talents, désireux de s’illustrer par leur ingéniosité, au-delà d’un budget dérisoire, qu’une opportunité mercantile de retirer un petit bénéfice d’une « œuvre » faite à la va-vite. A la vue de ce Shadow : Dead Riot, on est d’ailleurs vite tenté de le situer dans cette catégorie de divertissements. L’affiche ressemble en effet plus à une sorte d’avertissement invitant le spectateur à détourner son chemin qu’à un aperçu éveillant l’intérêt. Derek Wan ne s’étant jusque-là illustré qu’en tant que directeur de la photographie dans des productions hongkongaises (et en tant que metteur en scène de deux téléfilms), on envisage cette expérience comme un entraînement, plus que comme la mise en images d’un récit avec une vision. Et pour pallier le manque de poids de son nom, on lui octroie deux vedettes d’un cinéma autre, Tony Todd, qui a connu la gloire dans Candy Man (et qui a déjà eu l’occasion de partager l’écran avec des goules dans le remake de Night Of The Living Dead, par Tom Savini), et Misty Mundae, actrice qui a réussi à se faire un nom dans le cinéma indépendant tendance trash. Or, la présence de ces « grands » noms ne garantit pas, comme on peut s’en douter, un budget confortable. L’actrice principale a une carrière bien plus modeste, même si elle a fait de la figuration dans Inside Man de Spike Lee. Mais la grande surprise de ce Shadow : Dead Riot se situe dans son générique, qui annonce fièrement la présence de Tony Leung Siu Hung au poste de chorégraphe des scènes d’action. Serait-on dans un film d’arts martiaux ?
Dès les premières images, on constate que Derek Wan a une belle expérience de directeur de la photographie. Si les décors (ou plutôt le décor) ne tromperont personne, l’image, qu’on devine tourner en DV, bénéficie d’un soin particulier, ce qui contribue à immerger dans l’ambiance sordide de cette introduction sanglante. Rituels vaudous, scarifications et cannibalismes sont les ingrédients de ce prologue un peu caricatural, mais réussi. On s’éloigne donc de l’image moderne du zombie dont la condition est le résultat d’expériences scientifiques, ou de la propagation d’un virus. Avec l’avalanche d’infectés courant dans tous les sens qu’on voit habituellement dans ce genre de production, ce choix plus proche de l’origine des morts-vivants est vraiment agréable. On peut y voir un opportunisme qui jouerait sur l’image de marque de Tony Todd, habitué du surnaturel et des rituels terrifiants avec la série des Candy Man. Mais cet élément est intégré naturellement au récit, et contribue à installer une ambiance pesante. Car tout en utilisant les clichés inhérents au genre et en se jouant d’eux, Derek Wan ne cède pas à la facilité du second degré facile. Le ton est plutôt sérieux, même si les personnages versent dans les pires clichés. Carla Greene, dans le rôle de « Solitaire », joue les héroïnes chevaleresques, avec une dureté surprenante, qui détone au milieu du jeu des autres acteurs. Il suffit de voir le médecin lubrique en action, s’évertuer à exprimer le désir par les grimaces les plus spectaculaires. La subtilité ne s’arrête pas là, comme l’illustre le choix du prénom Elsa pour la gardienne homosexuelle prête à tout pour obtenir les faveurs des prisonnières. A ce titre, comme dans un grand nombre de films de prison pour femmes, l’homosexualité entre détenues et les abus prennent une place importante, « justifiant » les plans répétés sur les poitrines nues des actrices. Le premier tiers du métrage semble être l’occasion pour le réalisateur d’appliquer les quotas, puisque cet aspect ne sera presque plus présent l’heure restante. Bien sûr, la traditionnelle douche avec promesses d’abus reste présente, tout comme les tendances perverses du médecin, mais le récit va un peu dépasser cette accumulation de scènes faciles pour progresser davantage.
On peut en effet découper Shadow : Dead Riot en trois éléments : son contenu soft porn, destiné à attirer un public peu regardant de ce point de vue (à part quelques plans de nu, il n’y a aucune scène qui s’étire en longueur), les conflits entre l’héroïne et la prisonnière en chef, qui ferait passer Hulk Hogan (voire l’incroyable Hulk) pour une fillette, et le récit lié à la fameuse introduction. Dans tous les cas, il y a peu de chance pour que les scénaristes aient eu des migraines en rédigeant leur scénario. Outre les clichés inévitables (l’héroïne qui finit en isolement, mais est soutenue par sa voisine de chambre. Son éveil progressif à une plus grande humanité. Ses conflits avec la hiérarchie et les autres détenues.), les coïncidences qui conduisent certains personnages à se rencontrer dans certaines circonstances sont un peu trop ahurissantes pour être crédibles, même en faisant preuve de bonne volonté. Néanmoins, la volonté de plonger le récit dans une ambiance surnaturelle est appréciable. Wan parvient à tirer le meilleur de son décor, notamment la cellule d’isolement dont les murs semblent garnis de moisissure. Le lieu principal de l’action reste un grand couloir bordé de cellules, même si les douches sont beaucoup exploitées. Ce choix contribue à l’ambiance oppressante, en particulier lorsque les zombies envahissent la prison, donnant la sensation qu’il n’y a pas d’échappatoire. Il n’y a rien d’innovant, mais le travail est bien fait. Même certains effets spéciaux parviennent à être convaincants, comme ce passage où le sang se déverse dans les cellules. On apprécie d’autant plus qu’il aurait été facile de singer The Shining, mais Wan fait le choix de s’approprier cette situation, et elle sert réellement son propos. Autre scène qui rappelle un classique de l’horreur sans en être une simple copie : le bébé zombie. Comme dans Braindead de Peter Jackson, un rejeton mort-vivant va se montrer particulièrement vorace, mettant en valeur les maquillages réussis. Si le mannequin n’est pas très crédible, son attitude est vraiment inquiétante, loin de l’hilarité que pouvait provoquer l’ignoble enfant du film néo-zélandais. D’ailleurs, les maquillages sont plutôt réussis dans l’ensemble. Les visages des goules font penser à un assemblage d’immondices, rappelant bien leur décomposition et leur aspect putride, et les effets gores ne sont pas ridicules. Les moins réussis sont camouflés par un montage un peu plus frénétique, certains plans rappelant d’ailleurs Story Of Ricky et ses têtes explosées de marionnettes.
Car de façon surprenante, Wan ne surdécoupe pas ses scènes d’action, sauf, comme précisé précédemment, quand il est nécessaire de camoufler certains effets moins convaincants. L’émeute de l’introduction est significative de ce traitement. Le combat à grande échelle est assez maîtrisé, puisqu’on ressent pleinement le chaos, tout en ayant l’opportunité de voir ce qui se déroule à l’écran. Le travail de Tony Leung pour ce passage n’est pas inoubliable mais reste très sympathique, même si on aurait aimé que le tout dure plus longtemps. Les affrontements ne sont pas si nombreux que ça, mais ils sont dispersés avec suffisamment de régularité pour qu’on ne s’ennuie pas. La première heure alterne en effet combats, soft porn et scènes censées développer les liens entre les protagonistes. Mais c’est surtout pour son dernier tiers que Shadow : Dead Riot mérite d’être vu. Dès que les zombies se décident à sortir de terre, l’action ne cesse plus. En fait, dès qu’on voit des mains dépasser d’une pelouse artificielle, le spectacle commence réellement. Ce passage rappelle les scènes bien plus réussies des deux premiers Return Of The Living Dead. Alors que les combats de la première heure se sont révélés sympathiques (grâce notamment à quelques chutes énergiques et quelques coups de pied brutaux), le long final va enfin mettre en valeur le talent de Tony Leung. Bien sûr, il ne s’agit pas d’un film d’arts martiaux, et les acteurs ne sont manifestement pas des athlètes émérites. Mais le chorégraphe parvient à insuffler suffisamment d’énergie tout en variant le type d’action pour qu’on se laisse convaincre. Le passage à tabac des zombies à ce titre particulièrement jouissif, même si on aurait apprécié des mises à mort plus violente. Les morts-vivants quant à eux se montrent agressifs, n’hésitant pas à dévorer leurs victimes. Dommage que le budget pour l’hémoglobine n’est pas été plus important, d’autant plus que les quelques effets auxquels on a droit sont réussis. On a finalement plus l’impression d’être dans un beat ‘em all grandeur nature que dans un film d’horreur, même si Tony Todd se charge de nous rappeler qu’il est un véritable monstre. Son duel avec l’héroïne comporte d’ailleurs quelques un des meilleurs échanges. Mais l’équipe privilégie les confrontations courtes et variées plutôt que les longs duels complexes. Le fan d’arts martiaux peut le regretter, mais il faut garder à l’esprit que ce parti-pris évite de mettre en valeur l’inexpérience du casting. De plus, le final étant très long, le rythme n’en est que plus trépidant.
La conclusion est brève mais illustre bien ce à quoi on vient d’assister : un spectacle modeste mais sympathique, fait avec plus de soin que ce qu’on aurait pu croire. On pourra s’étonner de trouver Tony Leung au poste de chorégraphe dans un film de zombies US, mais son expérience permet de passer un bon moment, en particulier lors du très sympathique final. Shadow : Dead Riot n’a rien d’un film inoubliable, mais il reste un petit budget plus que regardable.
|
 |
 |
Léonard Aigoin 1/30/2011 - haut |
 |
 |
Karate Kid (2010) |
 |
 |

 On ne le répètera jamais assez, Jackie Chan est un mythe vivant, le personnage ayant à ce point remplacé l’homme que chaque incartade de l’acteur fait l’objet d’interminables débats. Entre les fans inconditionnels, prêts à tout pardonner à leur idole, les déçus qui espèrent encore assister à la résurrection artistique mais restent critiques, et les antis qui de toutes manières ne laissent rien passer, la star est de toutes manières un objet d’attention presque omniprésent. Ces dernières années, sentant peut-être le poids des années et prenant enfin conscience qu’il ne peut plus être crédible en jeune premier athlétique, Chan tente de prouver sa légitimité en tant qu’acteur. On l’a vu ainsi s’écarter progressivement du personnage qu’il a lui-même créé avec tant d’acharnement depuis des années. Mais enfermé dans une image un peu lisse, et habitué à grimacer à des fins comiques, l’acteur a du mal à construire cette nouvelle carrière à laquelle il aspire tant. Il y a une sorte de dédoublement, entre sa volonté de casser son image de gentil garçon et la peur de perdre son public. Shinjuku Incident est l’exemple le plus frappant de cette confusion, puisqu’on y voit un personnage frappé par le destin, cédant à des pulsions surprenantes (outre la violence graphique, Chan se permet une incartade auprès d’une prostituée, lui qui a proscrit le sexe de son cinéma jusque-là), sans qu’on y croit. Et si la démonstration n’est pas concluante, c’est parce qu’au milieu de cette histoire sombre, de ce portrait qui pourrait être sans concession, l’acteur se sent obligé de rassurer : « oui je joue un personnage sombre et plus mature, mais je reste le gentil, celui qui essaie de revenir vers le droit chemin et qui fait la morale ». Cette démarche intéressante mais pas encore concluante, est au centre de ce Karate Kid. Car cette nouvelle incursion Hollywoodienne est à l’image de la carrière récente de Chan : double, oscillant constamment entre sincérité et objectifs purement mercantiles. Il serait naïf de penser que l’argent n’est pas au centre des discussions quand il est question de réaliser un film. Et ce projet de « remake » peut difficilement être appréhendé comme autre chose qu’un véhicule pour Jaden Smith, puisque ce sont ses parents Will Smith et Jada Pinkett Smith qui font office de producteurs. D’ailleurs, tout est fait pour montrer ses talents, de ses démonstrations de danse à sa mise en valeur dans les combats en passant par la chanson du générique de fin dans laquelle il rappe aux côtés du prodige Justin Bieber. On ne le répètera jamais assez, Jackie Chan est un mythe vivant, le personnage ayant à ce point remplacé l’homme que chaque incartade de l’acteur fait l’objet d’interminables débats. Entre les fans inconditionnels, prêts à tout pardonner à leur idole, les déçus qui espèrent encore assister à la résurrection artistique mais restent critiques, et les antis qui de toutes manières ne laissent rien passer, la star est de toutes manières un objet d’attention presque omniprésent. Ces dernières années, sentant peut-être le poids des années et prenant enfin conscience qu’il ne peut plus être crédible en jeune premier athlétique, Chan tente de prouver sa légitimité en tant qu’acteur. On l’a vu ainsi s’écarter progressivement du personnage qu’il a lui-même créé avec tant d’acharnement depuis des années. Mais enfermé dans une image un peu lisse, et habitué à grimacer à des fins comiques, l’acteur a du mal à construire cette nouvelle carrière à laquelle il aspire tant. Il y a une sorte de dédoublement, entre sa volonté de casser son image de gentil garçon et la peur de perdre son public. Shinjuku Incident est l’exemple le plus frappant de cette confusion, puisqu’on y voit un personnage frappé par le destin, cédant à des pulsions surprenantes (outre la violence graphique, Chan se permet une incartade auprès d’une prostituée, lui qui a proscrit le sexe de son cinéma jusque-là), sans qu’on y croit. Et si la démonstration n’est pas concluante, c’est parce qu’au milieu de cette histoire sombre, de ce portrait qui pourrait être sans concession, l’acteur se sent obligé de rassurer : « oui je joue un personnage sombre et plus mature, mais je reste le gentil, celui qui essaie de revenir vers le droit chemin et qui fait la morale ». Cette démarche intéressante mais pas encore concluante, est au centre de ce Karate Kid. Car cette nouvelle incursion Hollywoodienne est à l’image de la carrière récente de Chan : double, oscillant constamment entre sincérité et objectifs purement mercantiles. Il serait naïf de penser que l’argent n’est pas au centre des discussions quand il est question de réaliser un film. Et ce projet de « remake » peut difficilement être appréhendé comme autre chose qu’un véhicule pour Jaden Smith, puisque ce sont ses parents Will Smith et Jada Pinkett Smith qui font office de producteurs. D’ailleurs, tout est fait pour montrer ses talents, de ses démonstrations de danse à sa mise en valeur dans les combats en passant par la chanson du générique de fin dans laquelle il rappe aux côtés du prodige Justin Bieber.
Et la musique joue un rôle non négligeable dans la promotion du film. Dès les premières images, un R’n’B des plus anecdotiques vient nous rappeler que le héros est déjà cool à 12 ans. Comment ne pas aborder l’immanquable utilisation de Lady Gaga, dont l’omniprésence dans tous les médias finit par être agaçante, indépendamment de ce qu’on peut penser de son travail. Par la suite, c’est un rap en mandarin qui s’inscrit dans la promotion d’une Chine moderne, illustrée par des plans répétés sur les infrastructures dernier cri comme le stade olympique. La bande originale en elle-même est orchestrée par James Horner, artiste réputé habitué des grosses productions, qui livre un travail aseptisé (et pas toujours en phase avec l’action) suffisamment propre pour ne pas gêner le grand public tout en donnant l’impression de voir du grand spectacle. Le côté visite touristique est donc tout à fait dans le ton d’un récit qui pourrait presque être considéré comme une grande pub, faisant autant la promotion de sa jeune star que de la Chine actuelle. En plus de rassurer le public en véhiculant une image moderne de Pékin, Karate Kid lui rappelle que l’exotisme ambiant ne le perdra pas, grâce à une philosophie martiale plutôt caricaturale. Les propos philosophiques de comptoir sont nombreux, Chan étant relégué dans un premier temps au rôle d’ermite dont l’isolement pourrait être dû à son obsession pour les proverbes simplistes tels que « Le kung fu est dans tout ce qu’on fait». Même les visions un peu plus dures sur la Chine sont vite contrebalancées. L’éducation presque spartiate d’une jeune fille prodige du piano sera ainsi compensée par la gentillesse du père derrière son masque strict. De même, la violence du maître interprété par Yu Rong Guang servira de catalyseur pour mettre en valeur le sens du « vrai » kung fu, symbolisé par Chan. L’acteur est d’ailleurs une fois de plus sous-exploité, incarnant une nouvelle fois l’antagoniste de Jackie Chan (ce qui semble presque être son seul rôle ces dernières années), sans pour autant le combattre, ce qu’on ne peut que regretter quand on connaît ses capacités martiales. Le propos paraît donc plutôt superficiel, ce qui n’est pas très étonnant dans un remake de Karate Kid.
Seulement Karate Kid n’est pas un remake. Les seuls points communs avec l’œuvre d’origine sont le titre et le fait qu’un asiatique qui n’est plus dans la fleur de l’âge apprend les arts martiaux à un petit américain. Il est d’ailleurs regrettable de constater que pour vendre, il faut parler de karaté plutôt de kung fu. Pourtant, malgré les facilités du marketing, ou les raccourcis scénaristiques, Harald Zwart livre une œuvre hybride, pleine de sincérité. Ce constat n’est pas évident, la réalisation étant plutôt impersonnelle. Mais Karate Kid est un film qui se découvre progressivement, et sa durée permet de s’immerger progressivement dans cette histoire simple mais touchante. La place d’étranger dans un pays aux coutumes si différentes est d’ailleurs bien retranscrite dans la première partie du récit, qui prend le temps de présenter les personnages et de les immerger dans ce monde très animé. Outre l’aspect carte postale, qui met en valeur de très beaux paysages, c’est réellement ce bouillonnement d’activité qui permet de comprendre la spécificité de cette culture, et c’est finalement dans ces passages qu’on a l’impression que le réalisateur veut nous faire découvrir la Chine, plutôt que quand il nous assène philosophie de comptoir et publicités du parti. De même, on a par moments la sensation d’assister à de vraies références au cinéma de Hong Kong, comme cet entraînement où l’on nous montre les ombres, qui n’est pas sans rappeler Once Upon A Time In China 2. L’apprentissage des techniques de combat est finalement rapidement expédié au profit d’un éveil, certes superficiel mais sincère, à une certaine spiritualité. Et si ces parti-pris donnent un rythme plus contemplatif que trépidant au film, l’action reste présente. Il n’y a en fait que deux scènes spectaculaires, sans pour autant qu’on s’ennuie.
Entre une course-poursuite acrobatique dans les rues et le tournoi de fin, l’équipe de cascadeurs à l’opportunité de démontrer ses talents. Les jeunes athlètes sont en effet impressionnants, même si leur manque d’expérience du point de vue cinématographique se ressent dans leur façon d’interpréter les enchaînements un peu plus élaborés. Globalement, les chorégraphies restent de toutes manières peu élaborées. Il y a bien sûr une volonté de présenter des affrontements plus techniques que dans le film d’origine, mais finalement, on insiste davantage sur quelques coups acrobatiques que sur des figures martiales développées. Le résultat est malgré tout satisfaisant pour une production de genre. Jaden Smith est plutôt souple, mais il ne dégage aucune puissance et n’est pas très crédible en combattant surdoué, à qui il suffit d’apprendre quelques semaines pour battre des jeunes à qui l’on enseigne les arts martiaux depuis des années. Il est bien plus convaincant lorsqu’il doit prendre la fuite. C’est finalement Jackie Chan qui se montre le plus intéressant, même s’il ne combat véritablement que le temps d’une scène. Après avoir cherché à prouver qu’il était encore suffisamment vif pour battre plus jeune que lui dans New Police Story, il corrige cette fois une bande d’adolescents de 13 ans sans aucun remord. Cet affrontement est non seulement plus vif que tous les autres, mais permet de constater que sans câbles ni doublure, la star est tout à fait capable de s’imposer physiquement si la chorégraphie n’est pas trop extravagante. Le montage de ces scènes d’action est à l’image du film : double. On sent la volonté de rendre les duels lisibles, mais la nécessité d’abuser des gros plans et du surdécoupage diminue l’efficacité du rendu. Le résultat reste plus recommandable que ce à quoi on assiste encore dans bon nombre de films à l’heure actuelle.
Mais l’action n’est pas le cœur de l’intrigue, contrairement à ce qu’on pourrait croire. Karate Kid est avant tout l’histoire d’une rencontre, celle de deux êtres qui ont connu la perte et qui semblent ne pas trouver leur place. Jaden Smith joue son rôle sérieusement, et sans se montrer exceptionnel, il livre un bon travail. Mais c’est véritablement Jackie Chan, même s’il n’apparait que tardivement, qui constitue la surprise du film. Si une fois de plus, il surjoue dans une scène dramatique larmoyante, il se montre bien plus sobre que d’habitude. Pour une fois, il n’abuse pas des grands sourires, mais donne du sens à son jeu, nous faisant découvrir progressivement un personnage plus profond qu’il n’y parait. En ne cherchant pas à s’éloigner radicalement de son style de prédilection, les films grands publics, il trouve un rôle dans lequel il réussit à s’immerger, au point de presque disparaître derrière le personnage. Pour une fois, il ne joue pas Jackie Chan, ou Jackie Chan jouant un rôle, il interprète un personnage. Et si la marge de progression existe toujours, il s’investit avec une sincérité réjouissante, qu’on aimerait retrouver à l’avenir. Rien que le fait de le voir jouer un homme de son âge, aux cheveux grisonnants et à la démarche moins assurée, a quelque chose de touchant.
Alors bien sûr, Karate Kid n’est pas un film inoubliable, et ses intentions mercantiles sont évidentes. Mais ces constats ne l’empêchent pas d’être une œuvre sincère et touchante, aux personnages attachants, et qui nous montre un Jackie Chan humain, et plus une image aseptisée ou une anti-image artificielle. Un divertissement pour la famille, qui se permet d’être un peu plus sombre, sans céder à la violence gratuite.
|
 |
 |
Léonard Aigoin 1/25/2011 - haut |
 |
 |
Hero Of Swallow (1996) |
 |
 |

 Au début du XXème siècle, en Chine, sévit un bandit nommé Hero Of Swallow (le "héros des hirondelles"), un hors-la-loi qui vole les riches pour donner aux pauvres. Sous sa véritable identité, Yuen (Yuen Biao), il part à la recherche de sa fiancée, Chinny, kidnappée sous ses yeux et envoyée dans un bordel de Pékin. Arrivé dans la capitale, la police locale n'aura de cesse que de le capturer. (DOV) Au début du XXème siècle, en Chine, sévit un bandit nommé Hero Of Swallow (le "héros des hirondelles"), un hors-la-loi qui vole les riches pour donner aux pauvres. Sous sa véritable identité, Yuen (Yuen Biao), il part à la recherche de sa fiancée, Chinny, kidnappée sous ses yeux et envoyée dans un bordel de Pékin. Arrivé dans la capitale, la police locale n'aura de cesse que de le capturer. (DOV)
 Quelle est la différence entre un acteur et une star ? Un acteur peut-il être une star et inversement ? Ces questions sont inévitables quand on s’intéresse à l’industrie (un mot qui n’a rien d’innocent dans ce contexte) du cinéma. Hollywood est le lieu où les stars assurent le show même lorsqu’elles sortent de la pharmacie ou d’une séance de shopping, poursuivies impitoyablement pas les paparazzis. A Hong Kong, les stars cumulent souvent les rôles, alternant plateaux de tournage et scènes de spectacle où elles chantent des tubes mielleux. Andy Lau est l’un des exemples les plus spectaculaires de ce phénomène (dénoncé avec humour dans le Heavenly Kings de Daniel Wu), mais même des stars de films d’action comme Jackie Chan ou Yuen Biao ont eu l’occasion de pousser la chansonnette à plusieurs reprises. Ainsi, dans un système où un film se vend sur ses têtes d’affiches plutôt que sur son sujet, il n’y a rien de surprenant à voir certains acteurs jouer leur personnage. C’est le cas de Jackie Chan, qui n’aura eu de cesse durant plusieurs années de vanter ses propres mérites dans des films construits presque exclusivement autour de lui. Bruce Lee, avant lui, était un phénomène plus qu’un acteur. Le cas de Yuen Biao est un peu plus compliqué. Fantastique acrobate, il bénéficie d’une présence moins importante que ses « grands frères », Jackie Chan et Sammo Hung. Conscient que cette réalité ne lui permettrait pas de sortir de leur ombre, il a rapidement tenté de s’affranchir de leur influence. On the Run fut d’ailleurs l’occasion de démontrer que s’il n’avait pas le poids d’une grosse star, il possédait des talents d’acteur insoupçonnés. Hero Of Swallow est donc l’un des films qui se sont vendus sur son nom, au milieu des années 90, période décevante où il enchainait les petites productions. Quelle est la différence entre un acteur et une star ? Un acteur peut-il être une star et inversement ? Ces questions sont inévitables quand on s’intéresse à l’industrie (un mot qui n’a rien d’innocent dans ce contexte) du cinéma. Hollywood est le lieu où les stars assurent le show même lorsqu’elles sortent de la pharmacie ou d’une séance de shopping, poursuivies impitoyablement pas les paparazzis. A Hong Kong, les stars cumulent souvent les rôles, alternant plateaux de tournage et scènes de spectacle où elles chantent des tubes mielleux. Andy Lau est l’un des exemples les plus spectaculaires de ce phénomène (dénoncé avec humour dans le Heavenly Kings de Daniel Wu), mais même des stars de films d’action comme Jackie Chan ou Yuen Biao ont eu l’occasion de pousser la chansonnette à plusieurs reprises. Ainsi, dans un système où un film se vend sur ses têtes d’affiches plutôt que sur son sujet, il n’y a rien de surprenant à voir certains acteurs jouer leur personnage. C’est le cas de Jackie Chan, qui n’aura eu de cesse durant plusieurs années de vanter ses propres mérites dans des films construits presque exclusivement autour de lui. Bruce Lee, avant lui, était un phénomène plus qu’un acteur. Le cas de Yuen Biao est un peu plus compliqué. Fantastique acrobate, il bénéficie d’une présence moins importante que ses « grands frères », Jackie Chan et Sammo Hung. Conscient que cette réalité ne lui permettrait pas de sortir de leur ombre, il a rapidement tenté de s’affranchir de leur influence. On the Run fut d’ailleurs l’occasion de démontrer que s’il n’avait pas le poids d’une grosse star, il possédait des talents d’acteur insoupçonnés. Hero Of Swallow est donc l’un des films qui se sont vendus sur son nom, au milieu des années 90, période décevante où il enchainait les petites productions.
D’ailleurs, le générique d’introduction ne laisse aucun doute sur le budget. La musique est atroce, et le travail sur la photographie donne l’impression de regarder une production Seasonnal des années 70. Les bruitages sont également parmi les plus mauvais de l’époque, pour ne pas dire de l’histoire du film d’arts martiaux, en exagérant un peu. A titre d’exemple, que le coup soit porté ou qu’il soit paré, le son reste le même. C’est d’autant plus regrettable que le combat d’ouverture n’est pas mal chorégraphié. Mais il est difficile, au moins dans un premier temps, de s’immerger dans ce Iron Monkey du pauvre à l’aspect vieillot et amateur. On constate également rapidement que Yuen Biao est systématiquement doublé, un comble pour un artiste martial de son niveau, habitué à effectuer la majorité de ses cascades lui-même, voire à doubler ses partenaires. Comment croire que celui qui s’investissait à la place de Cynthia Rothrock dans les coups de pied acrobatiques de Righting Wrongs, en portant une horrible perruque blonde, est ici doublé pour des enchaînements basiques ? Car s’il n’a jamais prétendu ne jamais employer de doublure, contrairement à certaines de ses connaissances, l’acteur a à son actif un certain nombre de scènes périlleuses restées dans les mémoires, Comme la vrille du toit d’un immeuble dans Millionaire's Express, ou encore la fameuse cascade impliquant un petit avion dans Righting Wrongs de Corey Yuen. Dans Hero Of Swallow, hormis quelques passages câblés, on ne peut pas dire qu’il y ait réellement de cascades. Par contre, les combats sont nombreux, et relativement longs. Il parait donc légitime de se demander pourquoi l’acteur, blessé au dos au moment du tournage, n’a pas quitté le tournage pour se soigner. Mais ce genre de détail n’a jamais été un problème à Hong Kong, où les doublures sont aussi nombreuses que les acteurs, sinon plus, Eddie Ko étant également copieusement doublé. Cette pratique, excessive en l’occurrence (comme dans bon nombre des wu xia pian câblés de l’époque d’ailleurs), rend les combats pénibles à regarder. Le montage est classique, ne cherchant pas à cacher l’utilisation des doublures par des artifices qui rendraient l’action illisible, à tel point qu’il est impossible de ne pas remarquer la supercherie. La chorégraphie est par contre plutôt satisfaisante. L’utilisation des câbles n’empêche pas les duels d’être techniques, et leur durée donne de l’envergure à leur complexité. Par moments, les mouvements peinent à se renouveler, mais globalement, le niveau est bon. On n’atteint pas le niveau des classiques de l’époque bien sûr, mais le résultat dépasse les attentes.
Ce qui surprend davantage, c’est l’histoire. On sent en effet une réelle volonté d’immerger le spectateur malgré la réalisation plate, notamment en intégrant des seconds rôles attachants. L’intrigue est riche en incohérences, le héros masqué passant par exemple son temps à montrer ses capacités hors normes lorsqu’il est en civil, mais la dramaturgie est suffisamment convaincante pour qu’on se sente impliqué. Car comme beaucoup de films de Hong Kong, Hero Of Swallow est un mélange de genres, débutant comme un kung fu léger, voire comique par moments, avant de finir dans le drame. Le derniers tiers de l’histoire est d’ailleurs particulièrement audacieux pour une production de ce type, débordant d’une violence inattendue, et s’achevant dans le nihilisme le plus terrible. La portée très symbolique du final mélodramatique est d’ailleurs un peu excessive, et pourrait presque paraître hors de propos. Mais cette scène dégage une telle sincérité qu’on s’imprègne de l’ambiance. C’est aussi grâce à la qualité du climax que cet exploit est possible. Baignant dans un suspense glauque, ce passage crée un véritable sentiment de malaise, et assure le soutien du spectateur. Mais si cette prise de position existe, c’est parce que certains acteurs font un travail remarquable. On passera sur les actrices, qui jouent soit les damoiselles en détresse (Athena Chu n’a pas beaucoup plus à faire que pleurer et implorer), soit les gamines de rue fanfaronnes. L’ensemble du casting joue en fait comme dans les kung fu comédies traditionnelles, surjouant avec énergie. Mais Yuen Biao et Elvis Tsui s’investissent totalement. Ce dernier, plus réputé pour ses excès dans les catégories 3 au titre évocateur, se montre très sobre ici, rendant son personnage très juste, et exprimant incroyable la dignité et la loyauté. Mais c’est Yuen Biao, peut-être pour compenser son manque d’investissement dans les combats, qui joue réellement avec ses tripes. Tour à tour menaçant, furieux, héroïque, charmeur, amusant, puis figure tragique, l’acteur a l’opportunité d’interpréter un large éventail d’émotions. Et il le fait de façon convaincante et surtout naturelle. C’est d’ailleurs certainement l’une des raisons pour lesquelles on lui a confié le rôle de Tam See dans Hero, de Corey Yuen, remake du Boxer From Shantung de Chang Cheh. Mais si ce rôle lui a permis de briller dans une grosse production, on regrettera qu’aujourd’hui l’acteur se contente de petits rôles au cinéma, même si sa carrière sur le petit écran a connu une expansion qui lui permet d’enchaîner les tournages de séries mettant en valeur ses prouesses martiales.
Hero Of Swallow est loin d’être une réussite, accumulant au contraire les défauts irritants. Il s’en dégage néanmoins une sincérité, et parfois une audace qui rendent le visionnage obligatoire pour tout fan de Yuen Biao, même s’il est douloureux de le voir autant doublé.
|
 |
 |
Léonard Aigoin 1/18/2011 - haut |
 |
 |
Witch From Nepal (1986) |
 |
 |

 Alors qu'un Hongkongais (Chow Yun-fat) est en vacances au Népal avec sa petite amie (Cherie Chung), il aperçoit une mystérieuse jeune femme (Emily Chu). Lors d'une excursion, il la revoit avant d'être victime d'un accident. Alors qu'un Hongkongais (Chow Yun-fat) est en vacances au Népal avec sa petite amie (Cherie Chung), il aperçoit une mystérieuse jeune femme (Emily Chu). Lors d'une excursion, il la revoit avant d'être victime d'un accident.
Hospitalisé à Hongkong, il est suivi par la mystérieuse népalaise qui lui apprend qu'il est son maître et qu'il doit lutter contre les forces du mal...
 En 1975, Ho Meng-Hua réalisait Black Magic, dont le titre a le mérite d’être assez représentatif du sujet. Véritable objet mercantile, on y voyait de la sorcellerie et de l’érotisme, une recette qui constituait une partie du catalogue de la Shaw Brothers avant qu’elle ne succombe à la concurrence. Véritable mode, le film de sorcellerie a donc connu, outre trois volets de la série Black Magic, des représentants assez incroyables tels que Boxer's Omen, ou encore Seeding Of A Ghost. Et si la majorité de ces productions sont issues du studio qui a contribué à la mise en valeur d’artistes tels que Chang Cheh, la société de Raymond Chow s’est aussi essayée à ce genre bien particulier, même si on se rappellera davantage des fameuses Ghost Kung Fu Comedies popularisées par Sammo Hung et Lam Ching Ying. Witch From Nepal est l’une de ces tentatives sur laquelle on jettera un regard curieux, interpelé par l’équipe. C’est Chow Yun-Fat qui interprète le héros, quelques mois à peine avant d’obtenir la reconnaissance en tant qu’acteur avec A Better Tomorrow de John Woo. Il se voit donner la réplique par la débutante Emily Chu, qu’on a pu découvrir aux côtés de Jackie Chan dans Heart Of Dragon, mais aussi par Dick Wei, excellent artiste martial habitué aux rôles de bagarreurs belliqueux dans les films de Sammo Hung. Mais Witch From Nepal est aussi la deuxième réalisation du chorégraphe Tony Ching Siu Tung, après un Duel To The Death aussi surprenant que réussi. L’occasion de découvrir si son premier film était une authentique réussite ou un coup de chance de débutant ! Car en s’éloignant de son terrain de prédilection, les arts martiaux, l’artiste se lance dans une entreprise pour le moins audacieuse. A première vue, on pourrait penser qu’il existe un parallèle entre Witch From Nepal et le Seventh Curse de Nam Nai Choi, dans lequel Chow Yun-Fat fait d’ailleurs de la figuration. Il suffit de comparer les séquences de rituels tribaux dans ces deux films pour constater que les inspirations ne doivent pas être si éloignées. Mais si le réalisateur de The Cat et Story Of Ricky reste cohérent dans sa narration, Tony Ching Siu Tung surprend (ou trompe) le spectateur en mettant en scène une romance qui préfigurerait presque le Two Lovers de James Gray. En 1975, Ho Meng-Hua réalisait Black Magic, dont le titre a le mérite d’être assez représentatif du sujet. Véritable objet mercantile, on y voyait de la sorcellerie et de l’érotisme, une recette qui constituait une partie du catalogue de la Shaw Brothers avant qu’elle ne succombe à la concurrence. Véritable mode, le film de sorcellerie a donc connu, outre trois volets de la série Black Magic, des représentants assez incroyables tels que Boxer's Omen, ou encore Seeding Of A Ghost. Et si la majorité de ces productions sont issues du studio qui a contribué à la mise en valeur d’artistes tels que Chang Cheh, la société de Raymond Chow s’est aussi essayée à ce genre bien particulier, même si on se rappellera davantage des fameuses Ghost Kung Fu Comedies popularisées par Sammo Hung et Lam Ching Ying. Witch From Nepal est l’une de ces tentatives sur laquelle on jettera un regard curieux, interpelé par l’équipe. C’est Chow Yun-Fat qui interprète le héros, quelques mois à peine avant d’obtenir la reconnaissance en tant qu’acteur avec A Better Tomorrow de John Woo. Il se voit donner la réplique par la débutante Emily Chu, qu’on a pu découvrir aux côtés de Jackie Chan dans Heart Of Dragon, mais aussi par Dick Wei, excellent artiste martial habitué aux rôles de bagarreurs belliqueux dans les films de Sammo Hung. Mais Witch From Nepal est aussi la deuxième réalisation du chorégraphe Tony Ching Siu Tung, après un Duel To The Death aussi surprenant que réussi. L’occasion de découvrir si son premier film était une authentique réussite ou un coup de chance de débutant ! Car en s’éloignant de son terrain de prédilection, les arts martiaux, l’artiste se lance dans une entreprise pour le moins audacieuse. A première vue, on pourrait penser qu’il existe un parallèle entre Witch From Nepal et le Seventh Curse de Nam Nai Choi, dans lequel Chow Yun-Fat fait d’ailleurs de la figuration. Il suffit de comparer les séquences de rituels tribaux dans ces deux films pour constater que les inspirations ne doivent pas être si éloignées. Mais si le réalisateur de The Cat et Story Of Ricky reste cohérent dans sa narration, Tony Ching Siu Tung surprend (ou trompe) le spectateur en mettant en scène une romance qui préfigurerait presque le Two Lovers de James Gray.
Un constat qui n’a rien d’évident, puisque toute la première moitié du film est dénuée de la moindre vision. Si le prologue et l’introduction insistent sur la magie et sa confrontation avec la science, le récit peine à décoller, nous présentant un Chow Yun-Fat en touriste beauf, n’hésitant pas à déguster des mets que les autochtones ne peuvent qu’admirer en salivant, avant de tapoter la joue de ces pauvres bougres. Son Joe est immédiatement présenté comme un individu peu sympathique et sans empathie, préférant plaisanter lourdement qu’admirer les magnifiques paysages qui s’offrent à lui. Car le choix des décors est plutôt réussi, tout comme les musiques, qui apportent beaucoup de vie au récit, au gré de quelques expérimentations de montage audacieuses, comme cette marche d’éléphants appuyée par une mélodie pesante. Mais cette attitude irritante du protagoniste ne sera pas sans conséquences, puisqu’il va rapidement être confronté à une succession d’accidents mis en scène avec autant de conviction que les vidéos de famille envoyées à Vidéo Gag. A ce titre, le gros plan sur Chow tombant à la renverse avant même d’avoir touché la branche d’arbre censée l’assommer est assez incroyable, et illustre bien le côté très brouillon du film. Difficile d’imaginer que celui qui allait mettre en scène A Chinese Ghost Story à peine un an plus tard serait capable de livrer un travail aussi platement filmé. Les accidents de Joe bénéficient d’un montage dynamique, mais le reste du récit est montré avec autant d’énergie que ce qu’on peut voir dans les pires téléfilms. Car Joe, en plus d’être un plouc, a la mauvaise habitude de tomber partout. Alors que n’importe qui verrait que son prochain pas le plongera dans une rivière, notre héros fonce tête levée. A tel point qu’on ne compte même plus le nombre de fois où il va chuter, le final dépassant de loin les espérances de ce point de vue. Ce parti-pris est-il censé apporter une touche d’humour ? Difficile de dire si le film se prend au sérieux en vérité. Le ton est plutôt léger (pas autant que la consistance du scénario cependant), mais la romance est traitée avec tellement de sincérité qu’on a beaucoup de mal à savoir comment appréhender ce qu’on voit.
Car plus que Witch From Nepal, c’est "Ida And Sheila" qu’il aurait fallu appeler ce film, en hommage au Jules Et Jim de Truffaut, tant le chassé croisé amoureux a d’importance. On ne comprend d’ailleurs pas vraiment si Emily Chu pourchasse Joe à cause de son physique de mannequin ou parce qu’il a une allure héroïque avec son bermuda et ses chaussettes remontées jusqu’aux genoux. Mais qu’importe, puisque rapidement les deux héros vont avoir une liaison des plus romantiques, le temps de plusieurs scènes inoubliables, sur fond d’une chanson aux paroles riches de sens, alors même que Joe est fiancé ! Ces échanges amoureux seront d’ailleurs l’occasion de découvrir l’origine des étoiles filantes, mais aussi d’être confrontés à des fantômes d’électricité à la recherche de câlins. Et pour montrer que l’amour transcende les frontières, la culture et la langue, le dialogue le plus romantique sera uniquement ponctué de grognements. Mais si la romance est au premier plan, la magie n’est pas en reste, et si Mary Poppins rangeait les chambres en bougeant son nez, Emily Chu met la table d’un plissement des yeux. En bon élève de Uri Geller, Tony Ching Siu Tung prouvera à ses spectateurs la puissance de l’esprit sur la fourchette, mais aussi sur les emballages de sucre, puis enfin sur le café, afin qu’il y ait une véritable montée en puissance. Et alors qu’on pouvait s’attendre à voir ce passionnant apprentissage se dérouler en une courte scène, le réalisateur fait le choix de le développer sur 10 minutes, alors même qu’il ne sera plus jamais question de ce pouvoir par la suite. S’il y a bien un élément caractéristique de Witch From Nepal, c’est ce sens douteux de la narration, qui rend la vision ennuyeuse. Il faut tout de même attendre 45 minutes avant que le récit ne progresse un peu, et on n’aura jamais la satisfaction d’assister à une histoire construite. Les scènes superflues s’enchaînent, et sans parler de cohérence, rien n’est crédible. Comment expliquer cette scène hilarante de poursuite dans l’hôpital ? Emily Chu y retourne un matelas, avant d’être pourchassée par une cinquantaine d’infirmiers, décidément très réactifs et en sur-effectif, ce qui ne correspond pas trop à la réalité des nuits de travail dans le milieu hospitalier. On notera par contre le discours subversif de ce passage, puisque la jeune femme traverse un mur aussi épais qu’une feuille de papier, dénonçant aussi l’état catastrophique des bâtiments de Hong Kong.
Difficile donc de trouver un véritable fil rouge à une histoire sans queue ni tête, dans laquelle les événements s’enchainent sans réelle logique. On remarque par contre l’utilisation appuyée des animaux, qui illustre certainement un message caché. Outre les éléphants, on verra un chien se faire massacrer dans un montage qui a du inspirer Nam Nai Choi pour le combat chien/chat de The Cat, un homme panthère, et un professeur de ballet aussi gracieuse qu’un grizzly. Mais c’est finalement Joe qui permet de lier tous ces éléments, grâce à sa constante gaucherie, son égoïsme et sa malhonnêteté, qui ne se démentiront presque jamais notamment dans l’attitude très digne qu’il adopte face à ses conquêtes. Face à lui, Dick Wei semble plus largué que jamais, son rôle se résumant à courir face au vent en poussant des hurlements et en manifestant rageusement sa haine de la faune et de la flore. On s’étonnera d’ailleurs de le voir arriver à cheval lors de la confrontation finale alors qu’il ne s’est déplacé qu’à pieds jusque-là. Final d’ailleurs sans aucun rythme. On a bien du mal à croire que quatre chorégraphe, dont Philip Kwok et Tony Ching Siu Tung aient participé aux deux seules scènes d’action, tant elles se révèlent sans éclat. Mais malgré ses innombrables défauts, Witch From Nepal possède quelques arguments justifiant qu’on le regarde. Pour commencer, quelques effets spéciaux sont réussis (ce qui a de quoi surprendre quand on repense à cette panthère magique dessinée sur la pellicule), comme des éclats de verre impressionnants dans le final. Et comment condamner un film qui est tellement raté qu’il provoque le rire du début à la fin ? Bien sûr, son rythme détestable n’évite pas un certain ennui, mais on s’amuse tout de même beaucoup, même si ce n’est pas pour les bonnes raisons. Enfin, malgré le manque de consistance de la réalisation, Ching parvient à livrer une scène aussi surprenante que réussie dans un cimetière. S’inspirant de la sortie des morts de leur tombe dans Return Of The Living Dead et préfigurant celle de Return Of The Living Dead, cette scène bénéficie d’un soin qu’on ne trouve dans aucun autre passage de Witch From Nepal et se révèle même un peu angoissante, car elle baigne dans une atmosphère saisissante. Il faut dire que le travail sur la lumière et l’utilisation de la fumée sont très convaincants. Même les maquillages des zombies sont crédibles, ce qui n’était pas acquis. Leur démarche lente et leur avancée inexorable s’inscrivent naturellement dans la tradition des bons films du genre, rappelant d’ailleurs le travail sur l’atmosphère de Fulci. Ce bref éclat de talent ne sera malheureusement que peu exploité, puisque les morts-vivants n’auront pas l’occasion de mordre qui que ce soit, pas plus qu’on ne verra leur cervelle exploser. Le potentiel gore de ce passage est donc délaissé pour permettre à Tony Ching Siu Tung de reprendre le cours de son récit laborieux, et c’est bien regrettable.
Witch From Nepal est loin d’être ce qu’on pourrait qualifier de bon film. L’histoire n’a aucun sens, les acteurs sont en roue libre, la réalisation est molle, et on navigue constamment entre le rire et l’ennui. Mais tous ses défauts sont compensés par cette sincérité naïve, cette douce folie, et une véritable scène de zombies, même si elle ne termine pas en carnage. Face au délirant Seventh Curse de Nam Nai Choi, le film de Ching Siu Tung ne fait pas le poids, mais il peut être considéré comme un sympathique complément.
|
 |
 |
Léonard Aigoin 1/5/2011 - haut |
 |
 |
Beyond Hypothermia (1996) |
 |
 |

 Wu Chin-lin est un tueur à gage version féminin qui possède la particularité d'avoir une température sanguine de 32°c,ce qui lui confère un sang froid incroyable allant jusqu'à tuer une jeune enfant. Tout en remplissant ses contrats, elle tombe amoureuse d'un serveur de restaurant (Lau Ching Wan) qui va la sortir de cet univers glacial en lui donnant une chaleur qu'elle n'avait jamais rencontrée au paravent... Wu Chin-lin est un tueur à gage version féminin qui possède la particularité d'avoir une température sanguine de 32°c,ce qui lui confère un sang froid incroyable allant jusqu'à tuer une jeune enfant. Tout en remplissant ses contrats, elle tombe amoureuse d'un serveur de restaurant (Lau Ching Wan) qui va la sortir de cet univers glacial en lui donnant une chaleur qu'elle n'avait jamais rencontrée au paravent...
 Quand on a été assistant-réalisateur de John Woo sur des films tels que A Better Tomorrow, ou encore Hard Boiled, puis de Johnnie To sur Loving You, se lancer dans la réalisation de son propre polar semble être une évolution naturelle. Le réalisateur de The Killer ayant commencé par assister Chang Cheh, l’Ogre de Hong Kong avant de se faire le spécialiste du mélo polar ultra sanglant, on pouvait d’ailleurs s’attendre à ce que Leung s’inscrive dans cet héritage. Et si aujourd’hui, le réalisateur connaît le succès en mettant en scène des comédies, Beyond Hypothermia est fidèle aux codes des plus grands polars wooïens… mais aussi aux règles du cinéma de Johnnie To. Comme dans beaucoup de leurs films, le récit semble intemporel, ou du moins en décalage avec l’image actuelle de la société. Et pour illustrer cette existence marginale, les destins de deux personnages que tout oppose vont se croiser. Pour qu’une telle rencontre provoque une réaction chez le public, il existe un moyen aussi mercantile que simple : s’appuyer sur la popularité des acteurs. Lorsqu’il joue dans Beyond Hypothermia, Lau Ching-Wan est déjà un acteur confirmé, ayant fait quelques apparitions au cinéma dans les années 80 et enchaînant les tournages à un rythme frénétique dans les années 90. S’étant illustré à plusieurs reprises devant la caméra de Johnnie To, il deviendra même l’un des acteurs fétiches de sa société de production, Milkyway Image, il était donc tout naturel qu’il joue le premier rôle masculin. Mais contrairement à ce qu’on pourrait croire, son temps de présence à l’écran est des plus réduits, et il ne constitue finalement que l’un des éléments d’une sous-intrigue. Et si la présence de producteurs coréens implique également la mise en scène d’un acteur coréen, ce dernier n’aura l’occasion de grimacer en secouant sa mèche sur le côté que le temps de quelques scènes, son rôle se résumant à être haineux et vouloir se venger. Non, Beyond Hypothermia n’est pas un film dans lequel les héros sont des hommes. C’est bien l’histoire de Wu Chien Lien que l’on suit, c’est bien son destin que l’on découvre, et c’est bien elle qui irradie la pellicule de sa présence le temps de quelques minutes, comme Pat Ha à l’époque de On The Run (même si Yuen Biao lui rendait la réplique avec talent). Quand on a été assistant-réalisateur de John Woo sur des films tels que A Better Tomorrow, ou encore Hard Boiled, puis de Johnnie To sur Loving You, se lancer dans la réalisation de son propre polar semble être une évolution naturelle. Le réalisateur de The Killer ayant commencé par assister Chang Cheh, l’Ogre de Hong Kong avant de se faire le spécialiste du mélo polar ultra sanglant, on pouvait d’ailleurs s’attendre à ce que Leung s’inscrive dans cet héritage. Et si aujourd’hui, le réalisateur connaît le succès en mettant en scène des comédies, Beyond Hypothermia est fidèle aux codes des plus grands polars wooïens… mais aussi aux règles du cinéma de Johnnie To. Comme dans beaucoup de leurs films, le récit semble intemporel, ou du moins en décalage avec l’image actuelle de la société. Et pour illustrer cette existence marginale, les destins de deux personnages que tout oppose vont se croiser. Pour qu’une telle rencontre provoque une réaction chez le public, il existe un moyen aussi mercantile que simple : s’appuyer sur la popularité des acteurs. Lorsqu’il joue dans Beyond Hypothermia, Lau Ching-Wan est déjà un acteur confirmé, ayant fait quelques apparitions au cinéma dans les années 80 et enchaînant les tournages à un rythme frénétique dans les années 90. S’étant illustré à plusieurs reprises devant la caméra de Johnnie To, il deviendra même l’un des acteurs fétiches de sa société de production, Milkyway Image, il était donc tout naturel qu’il joue le premier rôle masculin. Mais contrairement à ce qu’on pourrait croire, son temps de présence à l’écran est des plus réduits, et il ne constitue finalement que l’un des éléments d’une sous-intrigue. Et si la présence de producteurs coréens implique également la mise en scène d’un acteur coréen, ce dernier n’aura l’occasion de grimacer en secouant sa mèche sur le côté que le temps de quelques scènes, son rôle se résumant à être haineux et vouloir se venger. Non, Beyond Hypothermia n’est pas un film dans lequel les héros sont des hommes. C’est bien l’histoire de Wu Chien Lien que l’on suit, c’est bien son destin que l’on découvre, et c’est bien elle qui irradie la pellicule de sa présence le temps de quelques minutes, comme Pat Ha à l’époque de On The Run (même si Yuen Biao lui rendait la réplique avec talent).
Car même si cette affirmation est dur à croire à une époque où tous les films durent au moins 2 heures, jadis les réalisateurs contaient des histoires en 1h30, et même moins. Un format propice à mettre en scène un récit rythmé d’où les scènes superflues sont exclues. Pourtant, dès les premières images, on se demande s’il était bien nécessaire d’ajouter des voix off qui non seulement détaillent sans subtilité les états d’âme de certains personnages, mais en plus récitent les répliques dans un anglais qu’il serait généreux de qualifier de médiocre. Le cinéma et la littérature sont deux médias différents. Lorsqu’on lit un livre, n’ayant pas d’image à notre disposition, il est intéressant de connaître les pensées des protagonistes. Mais dans un film, le recours à ce procédé est bien souvent une facilité censée pallier le manque de créativité, ou destinée à appuyer lourdement un propos au cas où le spectateur souffre de troubles de la compréhension. Et c’est effectivement la sensation que crée la narration de Beyond Hypothermia. Un constat d’autant plus regrettable que l’esbroufe parait dans un premier temps totalement absente. Après une introduction réussie car elle donne envie de s’immerger dans cette histoire qui s’annonce violente et poétique, on découvre notre tueuse dans ce qui semble être une usine à glace. Cette scène résume à elle seule le personnage : froide, calculatrice, méthodique, et surtout mortelle. Mais surtout, c’est sa capacité à s’adapter aux contraintes inattendues qui en fait un adversaire redoutable. Difficile d’imaginer une meilleure présentation que cette scène, filmé avec beaucoup d’efficacité par Patrick Leung. Pourtant, on sent le compromis au détour de deux gros plans totalement gratuits sur une strip-teaseuse. S’agit-il d’une directive des producteurs, qu’ils soient hongkongais ou coréens ? Peu importe, ce choix donne la sensation d’être devant un mauvais téléfilm alors que la mise en scène était jusque-là si maitrisée.
Rapidement le réalisateur rassure le spectateur, promenant sa caméra avec élégance, au gré d’une photographie très réussie, sans donner l’impression d’être trop travaillée. Le retour au domicile est un parfait exemple du montage efficace des scènes de tension, nous immergeant dans la paranoïa de la tueuse. Leung aura systématiquement recours aux plongées et aux contre-plongées de travers pour nous déstabiliser, et nous rappeler que ce monde n’est pas le nôtre, allant parfois même jusqu’à plaquer sa caméra au ras du sol. Et si ce parti-pris se révèle des plus convaincants, on regrettera un recours grossier aux symboles. Car n’ayant pas assez d’une course-poursuite entre la Corée et Hong Kong pour satisfaire aux exigences d’un long métrage, Leung va s’empêtrer dans une romance aussi insipide qu’inutile. Difficile en effet de croire que celle qui affirmait ne pas ressentir de sentiments cèderait aussi facilement devant le charme d’un Lau Ching-Wan, aussi charmeur soit-il. Ce dernier est un véritable rayon de soleil dans un récit nihiliste, grâce à sa stature rassurante et à son bagout. Mais plus que son jeu, c’est son aura d’acteur qui rend le propos plus léger. Lau a beau être talentueux, il ne peut pas réellement donner vie à un rôle plus creux qu’un pantin de bois. Une fois le film achevé, on ne retient de lui que les innombrables scènes dans lesquelles il éteint la lumière de son boui-boui. Outre le peu de consistance de son rôle, il devient vite agaçant de se voir jeter en plein visage la métaphore de ses nouilles bien chaudes qui viennent réchauffer le cœur glacé de notre tueuse à la température corporelle trop basse de 5 degré. On pourrait pardonner le manque de subtilité de ce message s’il ne nous était pas assené toutes les 5 minutes sans réellement approfondir le propos. Sans compter que ces scènes sont filmer avec complaisance dans un style tellement fleur bleue qu’on penserait presque qu’on ne regarde plus le même film. Trancher avec le ton violent des scènes de polar est un parti-pris compréhensible, mais l’ensemble ne se mêle pas harmonieusement. La musique devient agaçante, et il faut bien avouer que les dialogues sont écrits sans subtilité. Leung insiste également avec trop d’ardeur sur les regrets de la tueuse, infligeant incessamment au spectateur des plans la montrant en train de contempler une petite fille. Tsukaja Hojo s’est peut-être inspiré de Beyond Hypothermia pour certains épisodes de son manga Angel Heart, mais il a nettement amélioré la formule, et de ce point de vue, le temps ne joue pas en la faveur du film de Patrick Leung. La plupart des ficelles sont en effet archi-usées, et il faut faire preuve d’une volonté de fer pour ne pas prévoir les événements à venir. C’est d’autant plus regrettable que de ce point de vue, une scène en particulier parvient à surprendre par sa violence (scène qui aurait été ajoutée à l’insu du réalisateur par Johnnie To).
Mais non, Beyond Hypothermia conservera son mélange jusqu’à son climax, sans parvenir à créer un récit cohérent. Tout le monde ne peut pas réaliser The Killer. Pourtant, malgré la déception générale, la réalisation des scènes de tension est d’une telle maîtrise qu’on prend plaisir à assister à ces massacres. Il ne faut pas s’attendre à des ballets sanglants comme ceux qui ont fait la renommée de John Woo. Yuen Tak et Yuen Bun sont des chorégraphes très différents de Tony Ching Siu-Tung, et ils privilégient ici la brutalité pure, si bien que la plupart des affrontements ne durent pas plus de quelques secondes. Et c’est justement cette sècheresse, alliée à un montage très dynamique et à une caméra toujours en mouvement qui cerne parfaitement les gestes des protagonistes qui font de Beyond Hypothermia plus qu’un mélo polar à moitié raté. Leung a une véritable vision, il sait quand rendre l’action lisible, mais aussi quand employer des caméras tremblantes, au cœur de l’action. A ce titre, le climax est véritablement prenant, alternant fusillades furieuses et course de stock car pleine de rage et de désespoir. On pourrait craindre que le manque d’investissement émotionnel dû à l’écriture approximative des personnages serait un frein à l’efficacité de certaines scènes. Mais il n’en est rien car on ressent une réelle satisfaction barbare à être témoin de ces combats à mort. Reste que passé l’excitation de l’action, le final ne laisse pas grande impression et se révèle sans audace, un peu à l’image du film.
Beyond Hypothermia est un film à la réalisation impressionnante, visuellement encore très moderne, mais dont le traitement franchement brouillon et l’écriture approximative l’empêchent d’accéder a statut d’œuvre mémorable. Reste à espérer que Patrick Leung décide un jour de rectifier le tir en s’octroyant les services d’un scénariste décidé à raconter une bonne histoire pour enfin nous livrer son polar définitif !
|
 |
 |
Léonard Aigoin 1/3/2011 - haut |
 |
|

|